
20 % moins cher que la LLD classique. Plus rapide, plus souple, plus simple.




Découvrez Evera Lease, la nouvelle référence du leasing sur-mesure pour véhicules électriques et hybrides, neufs ou reconditionnés, dédié aux entreprises.

LLD flexible pour véhicules électriques et hybrides, neufs ou reconditionnés, dédiée aux entreprises.

Obtenez une simulation sur mesure selon votre flotte, votre budget et vos usages.

Des modèles récents, fiables et disponibles sous 30 jours. À vous de choisir.

Recharge à domicile, en entreprise ou en itinérance : on s’occupe de tout.

20 % moins cher que la LLD classique. Plus rapide, plus souple, plus simple.
Découvrez qui nous sommes, nos partenaires et notre actualité, et prenez contact directement avec notre équipe.
La plateforme intelligente pour piloter, optimiser et réduire les coûts de votre flotte simplement grâce aux données connectées.


Le copilote intelligent pour piloter votre flotte et réduire vos coûts.

Découvrez la plateforme tout-en-un pour digitaliser et optimiser votre flotte.

Estimez votre ROI en 2 minutes. En moyenne 30% d'économies.

Explorez l’ensemble des modules disponibles selon votre besoin.

Compatible avec toutes les flottes : thermique, hybride ou électrique.

Parlez à un expert, testez la plateforme, et découvrez Evera Fleet en action.
Evera Fleet, la plateforme intelligente pour piloter votre flotte et réduire vos coûts.

Automatisez le calcul des avantages en nature et facilitez la gestion RH.

Visualisez vos coûts en temps réel et identifiez les économies possibles.

Suivez vos véhicules en temps réel sans boîtier, quelle que soit la motorisation.

Anticipez les entretiens, gérez les incidents, restez toujours en conformité.

Centralisez, automatisez, et désignez en quelques clics pour éviter des majorations.

Posez vos questions, obtenez des analyses, optimisez avec l'IA embarquée.

Parlez à un expert, testez la plateforme, et découvrez Evera Fleet en action.
Guides, simulateurs, livres blancs, plongez dans tous nos contenus dédiés à la mobilité.

Calculez automatiquement les avantages en nature de vos véhicules.

Comparez vos coûts totaux actuels et les gains à espérer avec Evera.
Profitez d'un audit gratuit pour analyser l'état de votre flotte et identifier vos leviers d'optimisation.
Créez votre politique de mobilité sur-mesure et sélectionnez les bons véhicules selon vos besoins, votre fiscalité, et votre budget.

Simulez les économies réalisables grâce à Evera Fleet gratuitement.

Analyses, conseils et actualités sur la mobilité des entreprises.

Nos articles, actualités, guides, pratiques et simulateurs, outils gratuits pour mieux gérer et optimiser votre mobilité d'entreprise au quotidien.

.svg)
.svg)
Dans un contexte où la mobilité électrique s'impose comme une norme durable, choisir la bonne borne de recharge électrique devient essentiel pour optimiser votre expérience. Que vous soyez un particulier ou un gestionnaire de flotte B2B, ce guide complet 2026 vous aide à naviguer parmi les options disponibles. Nous explorerons les critères clés pour sélectionner la meilleure borne de recharge adaptée à vos besoins, en tenant compte des évolutions technologiques et réglementaires en France.
Pour les trajets longue distance, la rapidité est primordiale. Une borne de recharge sur autoroute doit offrir une puissance élevée, idéalement supérieure à 150 kW, pour minimiser les temps d'arrêt. En 2026, les réseaux comme ceux d'Izivia ou Fastned dominent, avec des connecteurs CCS ou CHAdeMO compatibles avec la plupart des véhicules électriques, y compris Tesla. Privilégiez les marques de borne de recharge publique certifiées pour leur fiabilité et leur intégration avec des applications de navigation.
Les bornes ultra-rapides de 350 kW, comme celles d'IONITY, rechargent 80 % d'une batterie en moins de 20 minutes. Elles sont idéales pour les flottes professionnelles, réduisant les coûts opérationnels de 30 % par rapport aux modèles standards. Choisissez en fonction de la compatibilité avec votre véhicule pour une efficacité maximale.
Pour un usage domestique, optez pour une borne de recharge monophasée de 7 kW, économique et facile à installer. Elle convient parfaitement aux recharges nocturnes, rechargeant une batterie moyenne en 8-10 heures. En 2026, les modèles intelligents avec gestion d'énergie solaire gagnent en popularité, surtout pour les hybrides rechargeables. Consultez notre guide d'installation de bornes de recharge pour une mise en place conforme aux normes françaises.
Les bornes de recharge triphasées de 11 kW ou plus sont recommandées pour les professionnels gérant des flottes électriques. Elles offrent une recharge plus rapide, jusqu'à 3 fois celle des modèles monophasés, et s'intègrent bien dans les parkings d'entreprise. Vérifiez la compatibilité avec votre réseau électrique pour éviter des surcoûts d'installation.
Pour les véhicules hybrides rechargeables, une borne de recharge de 3,7 kW suffit souvent, priorisant la portabilité et la simplicité. En 2026, les options avec mode éco-mode optimisent la consommation, idéales pour les usages mixtes en B2B. Les meilleures bornes de recharge pour hybrides incluent des fonctionnalités de suivi via app pour une gestion précise des coûts.
Les propriétaires de Tesla bénéficient des Superchargeurs dédiés, mais pour une installation privée, la meilleure borne de recharge pour Tesla est le Wall Connector de 11 kW, compatible avec le connecteur NACS. Elle recharge jusqu'à 44 km par heure, parfaite pour les flottes d'entreprise. Intégrez-la à votre stratégie ESG pour valoriser votre mobilité durable.
Le meilleur borne de recharge 7kW convient aux usages résidentiels, avec un coût d'achat autour de 500-800 €. Pour plus de puissance, le meilleur borne de recharge 11kW est idéal en B2B, rechargeant en moitié moins de temps mais nécessitant une installation triphasée. Notre comparatif des bornes de recharge en 2026 détaille les options les plus performantes.
Voici un aperçu des les meilleurs bornes de recharge pour voitures électriques en 2026 :
Pour un comparatif des bornes de recharge en 2026, évaluez la puissance, le prix et la compatibilité OCPP pour les réseaux professionnels.
Évaluez d'abord la puissance (7-22 kW) selon vos besoins quotidiens, puis vérifiez la certification IP pour l'extérieur. Budget moyen : 600-1500 €, avec aides fiscales jusqu'à 500 € en France. Pour les entreprises, priorisez l'intégration avec des logiciels de gestion de flotte.
Le choix et installation de bornes de recharge requiert une évaluation du site et des besoins en mobilité. En B2B, optez pour des solutions scalables comme celles d'Evera, intégrant leasing et TCO optimisé. Suivez nos 10 conseils agiles pour choisir la meilleure borne de recharge électrique : puissance, connectivité, coût total de possession et conformité aux normes européennes.
En 2026, priorisez les bornes bidirectionnelles V2G pour une recharge intelligente, avec une puissance minimale de 11 kW pour les pros. Le marché français prévoit une croissance de 25 % des installations publiques. Intégrez des cartes de paiement pour une gestion fluide des flottes.
La meilleure carte de recharge électrique en 2026 est celle de Plugsurfing ou ChargeMap, offrant un accès à plus de 500 000 points en Europe. Pour les entreprises, elle simplifie la facturation et le suivi ESG, réduisant les coûts de 15-20 %.
Pour les flottes B2B, choisissez des bornes de 22 kW avec protocoles OCPP pour une gestion centralisée. Elles optimisent le TCO et soutiennent les objectifs ESG en favorisant la recharge verte.
Intégrez-la via un leasing dédié, comme chez Evera, pour minimiser les investissements initiaux. Cela inclut la gestion de flotte et le calcul du TCO, aligné sur les normes européennes 2026.
Environ 10-15 ans avec maintenance régulière. Pour les pros, optez pour des garanties étendues couvrant les pannes liées à une utilisation intensive.
Oui, le crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) et les subventions régionales persistent, jusqu'à 40 % des coûts. Consultez Evera pour une optimisation fiscale.
Des marques comme ABB ou Schneider Electric pour leur robustesse et compatibilité avec les réseaux B2B. Elles assurent une interopérabilité avec plus de 90 % des véhicules électriques.
Privilégiez les 150 kW+ avec refroidissement liquide. En B2B, cela réduit les temps d'immobilisation de 50 %, boostant l'efficacité opérationnelle.
Absolument : une infrastructure de recharge verte améliore le score ESG de 10-15 points, démontrant un engagement RSE fort auprès des investisseurs.
Prêt à optimiser votre mobilité électrique ? Découvrez les solutions de leasing et gestion de flotte chez Evera pour un TCO maîtrisé et une conformité ESG. Contactez-nous pour un audit personnalisé !

.svg)
.svg)
La Fiat 500e La Prima 42 kWh représente une évolution audacieuse de l'icône italienne, adaptée à la mobilité électrique urbaine. Lancée en 2022 et affinée pour 2025, cette version 3+1 portes cible les flottes d'entreprises cherchant une solution compacte, zéro émission et accessible. Avec sa batterie de 42 kWh et son moteur de 118 ch, elle promet une autonomie WLTP de 311 à 321 km, idéale pour les trajets quotidiens en ville ou en périphérie. Mais au-delà des chiffres, cet essai explore ses atouts et limites pour les professionnels, en mettant l'accent sur le coût total de possession (TCO) et l'intégration en parc mixte. Pour optimiser votre stratégie, consultez notre simulateur TCO et découvrez comment intégrer des véhicules comme celui-ci dans votre flotte.
Dès le premier regard, la Fiat 500e La Prima impose son ADN : une silhouette rondelette et espiègle qui évoque les rues milanaises des années 60, mais modernisée pour l'ère électrique. Les portes s'ouvrent avec une fluidité rassurante, révélant un habitacle minimaliste où le cuir et les inserts chromés de la finition La Prima ajoutent une touche premium sans excès. Le poids plume de 1 325 kg se fait sentir immédiatement – la voiture semble agile, presque joueuse, comme si elle invitait à une virée citadine sans contrainte. Cependant, l'absence de toit ouvrant et la configuration 3+1 (avec une petite porte arrière supplémentaire) rappellent que l'espace reste un compromis. Pour les gestionnaires de flotte, cette première prise en main évoque une navette urbaine fiable, parfaite pour des commerciaux en ville, mais moins pour des trajets familiaux étendus. Imaginez-vous garer cette compacte (3,63 m de long) dans les ruelles étroites d'un centre-ville, sans stress de stationnement.

Le design extérieur de la Fiat 500e La Prima 42 kWh fusionne héritage et innovation : la calandre fermée, signature électrique, s'intègre harmonieusement aux rondeurs iconiques, tandis que les feux de jour LED en forme de "500" ajoutent une signature lumineuse distinctive. Les jantes en alliage de 16 pouces (de série en La Prima) et les rétroviseurs rabattables électriquement renforcent son allure chic, avec une peinture métallisée qui capte la lumière urbaine. L'allongement de l'empattement de 2,2 cm par rapport à la version thermique libère un peu d'espace sans alourdir la silhouette, maintenant un Cx aérodynamique de 0,30 pour une efficacité énergétique honorable.
Bien que charmante, la 500e souffre d'une visibilité arrière limitée par ses montants épais, et l'absence d'options comme des barres de toit la rend moins polyvalente pour les usages pros variés. Face aux normes 2025, ses plastiques extérieurs résistants aux rayures sont un plus pour les flottes exposées au stationnement en rue. Pour comparer avec d'autres compactes électriques adaptées aux entreprises, explorez notre guide pour choisir le bon véhicule électrique. Globalement, ce design séduit par son italianité, mais il manque d'audace face à des rivales plus anguleuses.
À bord, la Fiat 500e La Prima offre un environnement cosy orienté conducteur : les sièges avant en cuir chauffants enveloppent sans excès de fermeté, et le tableau de bord numérique de 10,25 pouces domine l'espace, avec des matériaux recyclés qui soulignent l'engagement éco-responsable. L'empattement étendu permet d'accueillir deux adultes à l'arrière via la porte 3+1, avec un dégagement aux jambes correct pour des trajets courts (environ 70 cm). Le coffre de 185 litres s'agrandit à 1 080 litres sièges rabattus, suffisant pour des outils pros ou des courses d'entreprise.
L'habitabilité arrière reste étriquée pour quatre occupants – c'est une 3+1 plus qu'une vraie 4 places – et l'absence de ports USB arrière ou de climatisation bi-zone limite le confort en flotte partagée. Les vibrations du moteur électrique sont inaudibles, mais le bruit de roulement sur bitume irrégulier filtre un peu trop. Pour les professionnels, cet intérieur minimaliste réduit les coûts d'entretien, mais il appelle à une car policy claire pour définir les usages. Imaginez un commercial seul ou en duo : l'espace suffit, avec une recharge sans fil pour le smartphone qui fluidifie les pauses.
.avif)
Sous le capot, le monomoteur synchrone à aimants permanents délivre 118 ch (87 kW) et 220 Nm de couple, alimenté par une batterie lithium-ion de 42 kWh (37,3 kWh utilisables) sur une plateforme dédiée 400 V. La transmission à rapport fixe assure une accélération linéaire, avec un 0-100 km/h en 8,6 secondes et une vitesse maximale bridée à 150 km/h. La puissance reste stable en recharge (102 kW à 80 % SOC, 95 kW à 20 %), un atout rare qui évite les chutes brutales observées chez certains concurrents.
Suffisante pour la ville, cette motorisation manque de punch en côte ou en dépassement autoroutier, où le poids de la batterie (294 kg) se fait sentir. Pas de modes de conduite multiples au-delà de Normal et Range, ce qui simplifie mais n'excite pas. Pour les flottes, la fiabilité du système (garantie 8 ans/160 000 km sur la batterie) et l'absence de consommables mécaniques baissent le TCO. Consultez nos avantages fiscaux pour les véhicules électriques pour voir comment cela impacte votre bilan.
Sur route, la Fiat 500e La Prima excelle en milieu urbain : le centre de gravité abaissé par la batterie sous les sièges confère une stabilité surprenante, avec un rayon de braquage de 9,3 m idéal pour les manœuvres en parking d'entreprise. Les reprises de 80 à 120 km/h en 6,4 secondes se révèlent fluides, et le freinage régénératif (ajustable via palettes) récupère jusqu'à 0,3 g, prolongeant l'autonomie sans à-coups. Sur autoroute, elle file à 130 km/h sans forcer, mais le vent latéral la fait osciller légèrement en raison de sa hauteur.
La direction assistée manque de consistance à mi-régime, et en courbes serrées, les pneus Michelin e.Primacy (185/65 R15) hurlent vite sur sol mouillé, limitant la motricité. Pour un usage pro quotidien (100-150 km), elle offre une conduite sereine, comme un kart électrique en ville. Comparée à d'autres citadines, elle brille par son plaisir de conduite, mais exige une infrastructure de recharge adaptée – voir nos solutions de recharge pour entreprises.
L'autonomie WLTP de 311-321 km se traduit en réel par 274 km en ville (13,6 kWh/100 km), 196 km en mixte (19 kWh/100 km) et seulement 159 km à 130 km/h (23,4 kWh/100 km). La consommation reste sobre grâce à l'aérodynamique et au mode Sherpa, qui optimise la régénération.
Recharge : AC 11 kW en 4h15 (0-100 %), DC 85 kW en 35 min (0-80 %). Pas de 800 V, donc pas ultra-rapide, mais la courbe de charge est linéaire sans surchauffe. Pour les flottes, cela convient aux pauses café en entreprise, avec un coût d'environ 3 €/100 km (tarif nuit). Limite : Sur autoroute, l'autonomie chute vite, rendant les recharges obligatoires. Pour optimiser, utilisez notre guide sur la gestion de l'autonomie électrique.

La La Prima embarque un écran central Uconnect 5 de 10,25 pouces avec Apple CarPlay/Android Auto sans fil, navigation TomTom et recharge sans fil Qi. Sécurité : freinage d'urgence autonome, maintien de voie, alerte collision et caméra de recul. Le système audio de 6 haut-parleurs est clair, et l'assistant vocal répond bien aux commandes basiques.
Pas de régulateur adaptatif de série ni de caméra 360°, et l'interface tactile peut distraire en conduite. Pour les pros, le GPS intégré et la connectivité facilitent le suivi de flotte via des apps tierces. Intégrez-la à notre plateforme Evera Fleet pour un suivi ESG optimisé.

Tarif de base : 39 900 € en France pour la La Prima 42 kWh, incluant équipements premium. Avec bonus écologique (jusqu'à 4 000 € en 2025) et exonération de TVS (0 g CO₂/km), le prix net descend sous 36 000 €. En LLD via Evera Lease, comptez 300-350 €/mois pour 10 000 km/an, entretien inclus. TCO à 5 ans : environ 0,25 €/km, inférieur aux thermiques grâce à l'absence de malus et aux économies d'énergie.
Surcoût initial vs. essence (5 000 €), mais amorti en 2 ans pour un usage urbain. Pour simuler votre avantage en nature, c'est un choix rentable.
Face à la Renault Twingo E-Tech (autonomie 190 km, moins chère mais moins équipée), la 500e gagne en style et espace. Contre la Peugeot e-208 (jusqu'à 400 km WLTP, 35 000 €), elle perd en autonomie mais excelle en agilité. La Mini Cooper SE (plus sportive, 32 000 €) offre plus de fun, mais un coffre plus petit. Dans notre top 5 des meilleures voitures électriques pour entreprises, la 500e se distingue par son ratio prix/plaisir, idéale pour PME urbaines, mais moins pour les longs trajets où la Zoé domine.
La Fiat 500e La Prima 42 kWh séduit par son charme intemporel, son agilité urbaine et son TCO attractif (économies de 20-30 % vs. thermique sur 5 ans), en faisant un atout pour les flottes de PME en transition électrique. Ses forces : zéro émission pour les ZFE, facilité de recharge et fiabilité. Limites : autonomie routière modeste et espace arrière contraint, la réservant aux usages < 200 km/jour. Pour les entreprises, elle renforce l'image responsable tout en optimisant les coûts – un choix malin si complété par des modèles plus polyvalents. Chez Evera, nous la recommandons en LLD pour tester l'électrique sans engagement long terme.
Autonomie estimée : — km
* Estimation Evera Lease — données indicatives selon vitesse, température et charge.
.svg)
.svg)
2026 s’annonce comme l’une des années les plus importantes pour la mobilité électrique professionnelle. Plusieurs éléments convergent :
Les constructeurs européens, coréens et chinois préparent une vague de lancements majeurs pour 2026-2027, couvrant tous les segments : citadines low-cost, compactes polyvalentes, SUV électriques, berlines routières et modèles premium.
Pour les entreprises, ces nouveautés représentent une opportunité d’optimiser leur TCO, d’améliorer les AEN, et de préparer une stratégie multi-énergies cohérente grâce notamment à Evera Fleet.
Cet article présente les 15 modèles 100 % électriques les plus attendus en 2026.
Les citadines électriques sont le premier levier pour électrifier des flottes urbaines à coûts maîtrisés, notamment pour les usages du « dernier kilomètre », les visites en centre‑ville ou les petits déplacements quotidiens. En 2026, plusieurs modèles abordables arrivent sur le marché, avec des prix ciblés sous les 25 000 €.
La nouvelle Twingo électrique est annoncée comme une citadine très accessible, pensée pour le marché européen avec une forte vocation urbaine. Sa taille compacte, son rayon de braquage et son positionnement prix la destinent clairement aux flottes urbaines et parcs mutualisés opérant en ZFE.

La prochaine Spring, parfois évoquée sous le nom Evader, arriverait en fin 2026, étroitement dérivée de la nouvelle Twingo électrique. Dacia vise un prix sous les 18 000 € et une production européenne pour maximiser l’accès aux aides à l’achat, ce qui en fait une arme de volume pour l’électrification massive de petites flottes.
La nouvelle ID.Polo, équivalent électrique de la Polo, doit être dévoilée au printemps 2026 avec des livraisons attendues à la rentrée. Le modèle vise des autonomies d’environ 300 à 450 km et un prix de base autour de 25 000 €, ce qui en fait une candidate sérieuse pour les flottes voulant basculer leurs citadines thermiques.

Les compactes électriques vont devenir le segment pivot des flottes mixtes ville/route, avec un meilleur équilibre entre autonomie, confort et coût de détention. Elles sont appelées à remplacer progressivement les compactes thermiques dans les car policies.
Inspirée du concept THREE, la Ioniq 3 adoptera une silhouette de compacte fastback, reposant sur la base E‑GMP. Les batteries attendues (proches de celles de la Kia EV4) devraient permettre une autonomie dépassant les 600 km, intéressante pour les commerciaux grands territoires.
.avif)
La nouvelle génération de 208 100% électrique est pressentie pour un reveal au Mondial de l’Automobile d’octobre 2026, avec une autonomie pouvant s’approcher des 500 km. Elle reposera sur la base STLA Small et inaugurera un nouvel i‑Cockpit, ce qui en fait une option moderne et polyvalente pour les flottes urbaines et périurbaines.
L’Audi A2 e‑tron, compacte électrique annoncée pour fin 2026, viendra compléter l’offre du groupe sous les Q4 et ID.3. Avec une autonomie estimée autour de 400 km et un positionnement plus premium, elle parlera aux flottes haut de gamme qui veulent rester sur des formats compacts.
La Kia EV4, berline électrique à grande autonomie, est annoncée avec environ 625 km WLTP dans les premiers éléments communiqués. Elle se positionne comme une solution très compétitive pour les commerciaux grands rouleurs en quête d’un TCO maîtrisé et d’une image moderne.
Les SUV restent très demandés pour la position de conduite haute, le sentiment de sécurité et la capacité familiale. En 2026, plusieurs SUV électriques ciblent directement les parcs premium et les véhicules de fonction.
Sur base STLA Medium, le DS N°7 remplacera le DS 7 et proposera une version 100% électrique avec une grosse batterie autour de 97 kWh pour une autonomie proche de 750 km. Sa silhouette de SUV statutaire et son positionnement haut de gamme en font un modèle privilégié pour les directions et top managers.
Le Skoda Epiq, SUV urbain d’environ 4,10 m, doit concrétiser l’offensive citadine électrique du groupe Volkswagen en 2026. Il misera sur une excellente habitabilité, un coffre généreux (annoncé à 475 L) et des prix placés, ce qui en fait un outil intéressant pour les flottes cherchant du volume en SUV compact.

Le Volvo EX60, équivalent électrique du XC60, sera présenté le 21 janvier 2026, avec une arrivée sur routes françaises envisagée pour la fin du premier semestre. Volvo promet une nouvelle base technique plus efficiente (SPA3) et un tarif proche de l’actuel XC60 hybride rechargeable, ce qui est crucial pour le TCO en flotte premium.

Le Kia EV2, petit SUV sous les 30 000 €, est annoncé pour l’été 2026 avec une autonomie autour de 380–400 km. Il permettra aux flottes de proposer un SUV compact électrique accessible tout en restant attractif pour les collaborateurs.
Les berlines et breaks électriques de nouvelle génération veulent remplacer les thermiques sur les gros kilométrages, grâce à des autonomies supérieures à 700–800 km et des puissances de recharge élevées.
La future BMW i3 « Neue Klasse », version électrique de la prochaine Série 3, reprendra la base technique inaugurée par le SUV iX3. BMW vise une autonomie de plus de 800 km et une recharge jusqu’à 400 kW, ce qui en fait une candidate naturelle pour les grands rouleurs haut de gamme.

La Classe C 100% électrique, basée sur la plateforme MB.EA en 800 V, devrait arriver en 2026 avec une batterie autour de 94 kWh et une autonomie proche de 800 km. Une puissance de recharge annoncée jusqu’à 330 kW en fera un outil performant pour les longs trajets, tout en restant sur une silhouette classique rassurante pour la clientèle.
Certaines entreprises intègrent un modèle très statutaire pour la communication, les événements ou les dotations exceptionnelles, avec un impact fort sur la marque employeur.
Alpine arrêtera la production de l’A110 thermique mi‑2026 et enchaînera avec une nouvelle génération 100% électrique sur base inédite APP. Même si la version électrique pourrait arriver après 2026, son annonce et sa montée en puissance seront déjà structurantes pour l’image de l’électrique sportive française et les flottes cherchant un modèle vitrine.
La première Ferrari électrique, provisoirement baptisée Elettrica, est annoncée pour une première mondiale au printemps 2026, avec des livraisons attendues fin 2026. Cette GT 4 portes et 4 places dépassera les 1 000 ch, offrira environ 530 km d’autonomie grâce à une batterie de 122 kWh, et une recharge jusqu’à 350 kW. Pour une entreprise, il s’agit d’un pur véhicule image, mais au potentiel de communication colossal sur l’innovation et la performance électrique.
L’arrivée simultanée de citadines abordables, de compactes très efficientes, de SUV familiaux à grande autonomie et même de sportives emblématiques comme l’Alpine A110 électrique ou la Ferrari Elettrica transforme 2026 en véritable tournant pour le marché. Pour les entreprises, ce n’est plus seulement une question d’image verte : entre fiscalité de plus en plus incitative vers le zéro émission et durcissement progressif des malus pour les thermiques, l’électrique devient un choix rationnel de TCO et de conformité réglementaire.

.svg)
.svg)
Dans un contexte où la mobilité électrique gagne du terrain en France, le passeport batterie devient un outil clé pour les entreprises gérant des flottes de véhicules électriques. Obligatoire à partir de 2027 dans l’Union européenne, ce document numérique assure la traçabilité, la sécurité et la transparence des batteries. Pour les professionnels du B2B, il représente une occasion d’améliorer le suivi du cycle de vie des batteries et d’anticiper les futures exigences réglementaires.
Le passeport batterie : l’échéance approche, quel impact sur les flottes d’entreprise ?
À partir de 2027, toutes les voitures électriques devront disposer d’un passeport numérique des batteries, conformément aux directives européennes sur la durabilité. Ce système, qui inclut des informations sur la composition, l’origine et le recyclage des batteries, permettra une gestion plus efficace des ressources pour les acteurs de la mobilité B2B.
En France, où le marché des véhicules électriques pour flottes d’entreprise connaît une croissance rapide, ce passeport batterie voiture électrique devient un atout stratégique. Il facilite la conformité aux normes ESG et optimise le TCO (coût total de possession) en favorisant le recyclage des batteries, qui devient obligatoire pour tous les acteurs impliqués.
Le passeport batterie est un document numérique unique qui accompagne chaque batterie de véhicule électrique, contenant des données sur sa fabrication, son utilisation et son recyclage. Il sera obligatoire pour toutes les batteries industrielles de plus de 2 kWh à partir de 2027 en UE. Cela permet une traçabilité complète, réduisant les risques environnementaux et facilitant la revente ou le recyclage, avec un impact estimé à 20-30 % sur la durée de vie prolongée des batteries en flottes d’entreprise.
Voitures électriques : à quoi servira le passeport batterie ?
Cet outil numérique soutiendra des pratiques durables en rendant visible l’historique de chaque batterie, de la production à la fin de vie. Pour les gestionnaires de flottes B2B, il offre une transparence accrue, essentielle pour évaluer les performances et minimiser les coûts liés à la dégradation.
Le passeport numérique des batteries : le guide complet pour les entreprises.
Il inclut des QR codes pour un accès rapide aux données, favorisant la sécurité lors des maintenances et des échanges entre fournisseurs. En 2027, cela marquera le dernier morceau vers un cycle de la batterie entièrement circulaire, aligné sur les objectifs européens de neutralité carbone.
Les entreprises françaises investissant dans la mobilité électrique doivent anticiper ces changements.
Véhicules électriques : le passeport de batterie instauré en 2027 imposera un suivi rigoureux du recyclage. Avec des taux de recyclage visés à 95 % pour le lithium et le cobalt, les flottes B2B bénéficieront d’une économie circulaire qui réduit les coûts et les émissions. Passeport batterie : la clé de la traçabilité pour les flottes électriques d’entreprise en 2027 sera cruciale pour respecter ces normes.
Le passeport batterie améliore le TCO en prolongeant la vie utile des batteries via une traçabilité précise, potentiellement de 15-25 % selon les études européennes. Il facilite aussi le recyclage, réduisant les coûts de fin de vie estimés à 10-20 % du prix initial de la batterie. Pour les entreprises B2B, cela optimise les investissements en mobilité durable.
Les entreprises doivent auditer leurs flottes actuelles et former leurs équipes sur les outils numériques du passeport dès 2025. Intégrer des partenariats avec des fournisseurs certifiés UE assurera la conformité, avec un ROI visible en 2-3 ans via une meilleure gestion ESG. Evera propose des solutions de leasing adaptées pour anticiper ces transitions.
Le passeport batterie transforme la gestion des flottes électriques en France, en promouvant une mobilité responsable. Les entreprises qui s’y préparent dès maintenant gagneront en compétitivité et en conformité réglementaire.
Qu’est-ce que le passeport batterie et pourquoi est-il important pour les entreprises B2B ?
Le passeport batterie est un registre numérique qui trace le cycle de vie des batteries de véhicules électriques. Pour les flottes d’entreprise, il assure la conformité UE, optimise le recyclage et réduit les risques ESG, impactant positivement le TCO à long terme.
À partir de quand le passeport batterie sera-t-il obligatoire en France ?
À partir de 2027, toutes les batteries de voitures électriques neuves dans l’UE, y compris en France, devront inclure un passeport numérique. Les entreprises avec des flottes existantes auront une période de transition jusqu’en 2030 pour s’adapter.
Comment le passeport batterie influence-t-il le recyclage des batteries en B2B ?
Il rend le recyclage obligatoire et traçable, avec des objectifs de 95 % pour les matériaux critiques. Cela permet aux entreprises de valoriser les batteries usagées, générant des économies et soutenant les objectifs de durabilité ESG.
Quel rôle joue le passeport batterie dans la sécurité des flottes électriques ?
En fournissant des données sur l’historique et la composition, il aide à détecter les risques de défaillance précoce, améliorant la maintenance prédictive et réduisant les temps d’arrêt pour les gestionnaires de flottes B2B.
Les entreprises non-européennes sont-elles concernées par le passeport batterie ?
Oui. Toute batterie importée en UE pour des véhicules électriques doit respecter cette norme dès 2027, impactant les fournisseurs mondiaux et les flottes multinationales opérant en France.
Comment intégrer le passeport batterie dans une stratégie de leasing de flottes ?
Choisir des partenaires comme Evera qui intègrent la traçabilité dès le leasing permet une transition fluide. Cela inclut des audits batteries et des rapports ESG pour une gestion optimisée du cycle de vie.
Quel est le coût estimé d’implémentation du passeport batterie pour une flotte de 50 véhicules ?
Pour une flotte de 50 véhicules, les coûts initiaux de mise en conformité pourraient avoisiner 5 000 à 10 000 €, mais les gains en recyclage et TCO compensent en 2-3 ans via une meilleure valorisation des actifs.

.svg)
.svg)
La Porsche Taycan 4S Berline avec Batterie Performance Plus de 2023 représente l'incarnation premium de l'électrification chez le constructeur de Stuttgart. Dans un marché des berlines électriques en pleine effervescence, ce modèle vise les professionnels exigeants, alliant performances sportives et efficacité énergétique. Chez Evera, nous l'avons testé sur plus de 500 kilomètres mixtes, incluant autoroutes et routes sinueuses, pour évaluer son potentiel en contexte d'entreprise. Ce véhicule cible les flottes directionnelles où l'image de marque et la responsabilité environnementale priment, tout en maintenant un agrément de conduite exceptionnel.
Dès le premier regard, la Taycan 4S impose une présence magnétique. Sa silhouette basse et élancée, avec une longueur de 4,96 mètres, évoque la fluidité d'une GT classique tout en intégrant subtilement les codes de l'électrique : absence de calandre proéminente et lignes aérodynamiques optimisées pour un Cx de 0,22. L'accès à bord se fait avec une aisance surprenante pour une Porsche, grâce à des portes suicide-like en option qui facilitent l'installation des passagers arrière. Au démarrage silencieux, l'accélération linéaire et le couple instantané (710 Nm en mode Launch Control) procurent une sensation viscérale de puissance contenue. Sur le parking d'Evera, elle attire immédiatement les regards, renforçant son rôle de statement pour les dirigeants. Seule réserve : le poids de 2 220 kg se fait sentir à l'arrêt, rappelant que l'aluminium et la batterie alourdissent l'ensemble par rapport à une 911 thermique. Pour les professionnels, cette première prise en main souligne un véhicule taillé pour les trajets exécutifs, où le zéro émission s'accorde avec le prestige.
.avif)
Le design de la Taycan 4S Berline reste fidèle à l'ADN Porsche, avec une calandre "ferme" stylisée et des phares Matrix LED étirés qui confèrent une identité forte. Les jantes de 20 pouces en noir satiné, montées sur des pneus Michelin Pilot Sport EV, accentuent son allure athlétique, tandis que les prises d'air latérales fonctionnelles optimisent le refroidissement de la batterie. La carrosserie en aluminium, peinte ici en noir Jet pour un look discret professionnel, mesure 1,38 m de hauteur, favorisant une posture dynamique sans excès SUV. Critiquement, les rétroviseurs virtuels en option (caméras) réduisent la traînée, mais leur adaptation demande un temps d'habitude en usage urbain dense. Comparée à ses devancières, cette version 2023 affine les détails comme les feux arrière connectés qui s'étirent sur toute la largeur, créant un effet de profondeur nocturne impressionnant. Pour les flottes d'entreprise, ce design intemporel minimise la dépréciation, un atout clé en leasing longue durée. Si l'ensemble séduit par sa cohérence, il manque toutefois d'audace face à des rivaux plus futuristes, comme certains concepts Mercedes.
À l'intérieur, la Taycan 4S offre un habitacle spacieux pour une berline sportive, avec un empattement de 2,90 m qui libère les jambes avant et arrière. Les sièges en cuir alcantara ventilés et chauffants enveloppent le conducteur d'un maintien ferme, idéal pour des trajets autoroutiers de plus de 300 km sans fatigue. Le tableau de bord incurvé, dominé par deux écrans tactiles de 16,8 pouces (instrumentation et infodivertissement), délivre une interface fluide sous Porsche Communication Management (PCM). L'espace pour les passagers arrière est généreux pour deux adultes, mais le toit panoramique en verre optionnel réduit légèrement la garde au toit, un point critique pour les grands gabarits en costume d'affaires. Le coffre avant (frunk) de 81 litres avale les câbles de recharge, tandis que celui arrière de 407 litres convient pour un week-end exécutif, sans plus. Critiquement, l'absence de moquette épaisse rend l'habitacle un brin résonnant sur routes dégradées, et les commandes physiques (comme le mode de conduite sur le volant) pourraient être plus intuitives pour des conducteurs novices en électrique. Chez Evera, nous apprécions l'intégration d'Apple CarPlay sans fil, parfaite pour les visioconférences en déplacement. Pour en savoir plus sur l'optimisation des avantages en nature pour de tels véhicules, consultez notre guide sur les AEN 2025.

Sous le capot, la Taycan 4S embarque deux moteurs synchrone à aimants permanents (un avant de 190 kW, un arrière de 250 kW en overboost), délivrant 517 ch cumulés, gonflés à 598 ch via Launch Control. Le couple de 710 Nm propulse l'auto de 0 à 100 km/h en 3,7 secondes, avec une vitesse max bridée à 250 km/h. La batterie Performance Plus de 105 kWh bruts (97 kWh utilisables) à architecture 800 V assure une efficacité remarquable, avec une consommation mixte réelle autour de 20 kWh/100 km lors de notre essai. La transmission à deux vitesses sur l'essieu arrière simule une boîte mécanique pour une reprise plus vive, tandis que le Porsche Traction Management (PTM) distribue intelligemment le couple pour une motricité impeccable, même sur sol mouillé. Critiquement, en mode Normal, la consommation grimpe à 24 kWh/100 km en conduite dynamique, pénalisant l'autonomie sur longs trajets. Pour les entreprises, cette motorisation brille par sa linéarité, évitant les surconsommations thermiques, et s'intègre parfaitement à une stratégie d'électrification de flotte. Les modes de récupération d'énergie (jusqu'à 0,3 g en décélération) renforcent l'aspect éco-responsable, aligné avec les objectifs ESG.
Sur route, la Taycan 4S excelle par son châssis affûté, avec une suspension pneumatique adaptative à deux chambres et le Porsche Active Suspension Management (PASM) qui alternent entre confort feutré et tenue de cap incisive. Lors de notre parcours sur les routes varoises, elle avale les virages avec une précision chirurgicale, le centre de gravité bas (batterie sous les sièges) annihilant le roulis malgré les 2,2 tonnes. En mode Sport Plus, le son synthétique des moteurs et le feedback directionnel (variable en option) recréent l'essence Porsche, avec un rayon de braquage de 11,7 m facilitant les manœuvres urbaines. Sur autoroute, la stabilité à 130 km/h est irréprochable, et les roues arrière directrices (en option) aident aux insertions fluides. Critiquement, les pneus run-flat limitent légèrement le confort sur pavés parisiens, générant des vibrations perceptibles, et le poids se ressent en freinage d'urgence, où les étriers en acier (non carbones) chauffent vite. Globalement, cet essai routier confirme la Taycan comme une référence pour les professionnels en déplacement, où la performance n'altère pas la sérénité. Pour comparer avec d'autres berlines électriques premium, découvrez notre sélection des 5 meilleures voitures électriques pour entreprises en 2025.

Avec une autonomie WLTP de 549 à 642 km, la Taycan 4S Performance Plus tient ses promesses en conditions mixtes, notre essai enregistrant 520 km réels sur cycle autoroute-ville. La batterie 800 V permet une recharge ultra-rapide : 10 à 80 % en 18 minutes à 320 kW sur borne compatible, récupérant 299 km en 10 minutes. En AC 11 kW, une charge complète prend 11 heures, idéal pour une nuit au garage d'entreprise. Critiquement, en hiver ou à pleine charge, l'autonomie chute à 400 km, et les bornes 400 V limitent le débit à 135 kW (33 minutes pour 70 %). Le système de gestion thermique préconditionne la batterie pour optimiser les sessions, un plus pour les flottes nomades. Chez Evera, nous recommandons d'intégrer ce modèle à une infrastructure dédiée ; pour explorer nos solutions de bornes et badges de recharge, visitez nos offres de recharge pour entreprises. Bien que leader en rapidité, elle reste sensible à la température ambiante, un point à surveiller pour les usages intensifs.

La Taycan 4S intègre un arsenal technologique Porsche, avec le PCM 5.0 gérant navigation, connectivité 5G et hotspot Wi-Fi pour jusqu'à 15 appareils – parfait pour les réunions en déplacement. Les aides à la conduite incluent l'adaptatif InnoDrive (cruise control prédictif), la surveillance des angles morts et le freinage d'urgence autonome, notés 5 étoiles Euro NCAP. L'écran head-up display projette la vitesse et les flèches de navigation, tandis que l'audio Burmester 21 haut-parleurs enveloppe l'habitacle. Critiquement, l'interface tactile, bien que réactive, surcharge l'utilisateur avec ses multiples menus, et les mises à jour over-the-air (OTA) sont espacées, contrairement à Tesla. Pour les professionnels, la compatibilité avec les flottes connectées (via API Evera Fleet) facilite le suivi. Ces technologies renforcent la productivité, mais demandent une formation pour les conducteurs d'entreprise.
Tarifée à partir de 117 170 € en France (2023), la Taycan 4S Performance Plus grimpe vite avec options (jusqu'à 130 000 € pour notre exemplaire). En leasing LLD via Evera Lease, les loyers mensuels tournent autour de 1 000 € HT pour 48 mois/60 000 km, incluant entretien et assistance. Critiquement, le surcoût initial par rapport à une Panamera thermique (environ 20 % plus cher) pèse sur le TCO à court terme, malgré zéro malus CO₂ et TVS réduite (50 % d'abattement). La garantie batterie 8 ans/160 000 km rassure, mais la dépréciation reste élevée (environ 40 % après 3 ans). Pour les entreprises, les aides fiscales (bonus écologique résiduel et récupération TVA à 100 % sur recharge) amortissent l'investissement. Pour calculer précisément votre TCO, utilisez notre simulateur gratuit. Ce positionnement cible les flottes haut de gamme, mais exige une stratégie pluriannuelle pour rentabiliser.
Face à l'Audi e-tron GT (plus spacieuse, 500 km d'autonomie), la Taycan 4S l'emporte en agilité et recharge (18 min vs. 22 min), mais perd en coffre (407 L vs. 480 L). La Mercedes-AMG EQS 53 offre plus de luxe (écrans hyperscreen) et d'autonomie (660 km), mais sa consommation grimpe en dynamique (25 kWh/100 km). La BMW i7 M60xDrive rivalise en puissance (544 ch), avec un intérieur plus vaste, mais sa recharge 400 V est plus lente. Critiquement, la Taycan excelle en conduite pure, mais ses rivales allemandes gagnent en modularité pour usages familiaux ou commerciaux. Chez Evera, elle se distingue pour les directeurs en solo, alignée sur une mobilité premium zéro émission. Pour d'autres essais comparatifs, explorez notre article sur les berlines électriques premium.
La Porsche Taycan 4S Berline Batterie Performance Plus 2023 s'impose comme un choix d'excellence pour les flottes directionnelles chez Evera, où performances, prestige et zéro émission convergent. Ses atouts : accélération fulgurante, recharge 800 V et stabilité, en font un vecteur d'image forte pour les PME et ETI engagées en RSE. Cependant, son prix élevé et son coffre limité le destinent plus aux usages exécutifs qu'aux flottes polyvalentes.
Bilan : un véhicule qui élève la mobilité électrique sans compromis sur le plaisir, idéal pour une transition premium. Chez Evera, nous le recommandons en LLD pour maximiser les économies fiscales et le ROI sur 4 ans. Pour auditer votre flotte et intégrer la Taycan, contactez-nous via notre outil d'audit gratuit.
Autonomie estimée : — km
* Estimation Evera Lease — données indicatives selon vitesse, température et charge.
.svg)
.svg)
Le Hyundai Tucson Hybrid 215 Creative N-Line représente l'évolution d'un SUV compact qui vise à conquérir le segment des hybrides non rechargeables en misant sur un équilibre entre performance, technologie et design sportif. Dans un marché saturé de propositions similaires, ce modèle de 2025 se distingue par sa finition N-Line, qui injecte une dose d'agressivité esthétique sans sacrifier le confort quotidien. Destiné aux conducteurs exigeants, qu'ils soient en usage personnel ou professionnel, il promet une consommation modérée et une polyvalence accrue. Cet essai explore ses moindres recoins, en mettant l'accent sur ses forces et ses faiblesses, pour aider à décider si ce Tucson mérite une place dans une flotte ou un garage privé.
Dès les premiers regards, le Hyundai Tucson Hybrid 215 Creative N-Line impose une présence affirmée sur la route. Son gabarit généreux – 4,64 m de long, 1,86 m de large et 1,66 m de haut – lui confère une stature imposante, typique des SUV compacts actuels, mais rehaussée par les touches N-Line : jantes 19 pouces en alliage noir brillant, pare-chocs sportifs avec prises d'air élargies et un becquet arrière discret qui accentue son allure dynamique. La calandre Parametric Hidden, signature Hyundai, s'illumine de LED paramétriques qui s'animent à l'approche, créant un effet futuriste sans excès.
En s'installant au volant, l'habitacle respire la qualité, avec des matériaux mixtes cuir/Alcantara sur les sièges sport et un tableau de bord épuré dominé par deux écrans 12,3 pouces côte à côte. Le démarrage en mode électrique silencieux surprend agréablement, masquant la présence du moteur essence sous le capot. Cependant, les plastiques durs sur les contre-portes trahissent un certain compromis sur la finition haut de gamme, et le poids ressenti – près de 1 700 kg – se fait vite sentir en manœuvres urbaines. Globalement, ces premières impressions évoquent un véhicule mature, prêt à affronter autoroute et ville, mais qui pourrait gagner en légèreté pour une agilité immédiate. Pour approfondir les choix entre hybrides et électriques purs, consultez notre guide comparatif Hybride vs Électrique : lequel choisir en 2025 ?.
Le design extérieur du Tucson Hybrid Creative N-Line 2025 marque une continuité réussie avec la génération précédente, tout en affinant ses lignes pour un rendu plus athlétique. La face avant, avec sa calandre massive et ses phares LED "seamless" intégrés, projette une image moderne et agressive, renforcée par les éléments N-Line : logo spécifique, diffuseur arrière noir laqué et jantes 19 pouces au motif diamanté qui ajoutent une touche premium. Les flancs sculptés, avec des passages de roues prononcés, soulignent sa stature musclée, tandis que l'arrière adopte des feux horizontaux connectés qui s'étirent sur toute la largeur, pour un effet visuel élargi.
Les dimensions généreuses (empattement de 2,75 m) garantissent une stabilité visuelle, et les coloris bi-ton (comme le noir avec toit contrasté) personnalisent l'ensemble sans alourdir la silhouette. Critiquement, les rétroviseurs trop larges gênent parfois la visibilité latérale en stationnement, et l'absence d'options comme les étriers de frein Brembo visibles limite le côté "performance" pur. Néanmoins, ce design séduit par sa polyvalence : il passe sans complexe d'une réunion d'affaires à un week-end familial. Imaginez-le garé devant un bureau contemporain, sa carrosserie bleu océan reflétant la lumière, prêt à avaler des kilomètres sans effort apparent. Pour explorer d'autres SUV hybrides en essai, découvrez notre test du Renault Symbioz E-Tech Full Hybride.

À l'intérieur, le Tucson Creative N-Line offre un espace généreux qui justifie son appellation de SUV familial. Les cinq places accueillent sans peine des adultes de grande taille, avec 1,04 m d'espace aux jambes à l'arrière et un coffre de 616 litres (extensible à 1 799 litres sièges rabattus), idéal pour transporter bagages ou matériel professionnel. Les sièges avant, en cuir perforé avec surpiqûres rouges N-Line, sont chauffants et ventilés, procurant un maintien ferme sans rigidité excessive lors de longs trajets. Le volant gainé cuir, avec palettes de changement de vitesse, tombe naturellement sous les mains, et l'Alcantara sur les accoudoirs ajoute une texture tactile plaisante.
L'ergonomie est un point fort : les commandes physiques pour le climatiseur (bi-zone) cohabitent avec l'infodivertissement tactile, évitant les frustrations des interfaces 100 % numériques. Cependant, les aérations centrales basses diffusent mal l'air vers l'arrière, et les plastiques glossy autour des écrans attirent les traces de doigts, nuisant à l'aspect premium sur le long terme. L'éclairage d'ambiance à LED, réglable en 64 couleurs, crée une atmosphère cosy le soir, tandis que les portes s'ouvrent avec un bruit sourd et rassurant. On s'y sent protégé, comme dans un cocon high-tech, avec assez de rangements (console centrale coulissante, poches aérées) pour organiser un quotidien chargé. Pour calculer l'impact fiscal d'un tel véhicule en entreprise, utilisez notre simulateur Avantage en Nature 2025.

Sous le capot, le Tucson Hybrid 215 Creative N-Line embarque un système hybride auto-rechargeant éprouvé : un moteur essence 1.6 T-GDi turbo de 180 ch (132 kW) associé à un électrique de 44 kW, pour une puissance cumulée de 215 ch et un couple de 367 Nm. La batterie lithium-ion-polymère de 1,49 kWh se recharge via récupération d'énergie au freinage ou en décélération, sans prise externe. La boîte automatique à 6 rapports assure des passages fluides, priorisant l'efficacité sur la sportivité.
Ce duo délivre des performances solides – 0 à 100 km/h en 8,2 secondes, vitesse max limitée à 191 km/h – avec un mode électrique pur limité à 50 km/h et environ 2-3 km d'autonomie en ville. La consommation mixte WLTP s'établit à 5,8 l/100 km, réaliste en usage routier mais grimpant à 7 l en ville chargée. Critiquement, l'absence de 4x4 de série (option HTRAC à 2 000 €) limite la motricité sur sol glissant, et le bruit du moteur essence sous accélération forte rappelle qu'il s'agit d'un hybride, non d'un pur électrique. La suspension N-Line, plus ferme, absorbe bien les irrégularités sans talonner, offrant un compromis routier équilibré. Pour évaluer le coût total de possession, consultez notre simulateur TCO.
Sur route, le Tucson Hybrid 215 Creative N-Line révèle un comportement polyvalent qui flatte le conducteur sans le submerger. En ville, le mode hybride gère intelligemment les transitions essence/électrique, permettant des départs silencieux aux feux et une fluidité remarquable dans la circulation dense. Les aides au stationnement (caméra 360° et capteurs) facilitent les manœuvres, malgré le rayon de braquage moyen de 11,8 m qui le rend moins agile qu'un rival comme le Kia Sportage.
Sur autoroute, la stabilité est exemplaire grâce à l'empattement long et au centre de gravité bas ; à 130 km/h, le bruit reste contenu à 68 dB, et la consommation se stabilise autour de 6 l/100 km. Le mode Sport raffermit la direction (assistée électrique) et réveille le couple pour des reprises vives (70-120 km/h en 6 secondes), mais sans l'enthousiasme d'un vrai SUV sportif. En départementale sinueuse, la suspension pilotée (option à 800 €) excelle, limitant le roulis et maintenant une trajectoire précise, bien que le poids se fasse sentir dans les virages serrés. Freinage progressif, avec récupération d'énergie perceptible, et pneus Michelin Pilot Sport 4S qui adhèrent sans broncher. On imagine aisément une journée type : départ matinal fluide, croisière autoroutière reposante, et retour sinueux dynamique. Un bémol : les vibrations du moteur à bas régime en mode EV perturbent parfois l'harmonie. Pour d'autres essais de SUV, lisez notre analyse de la Peugeot E-208 GT 2025.

En tant qu'hybride non rechargeable, le Tucson Hybrid 215 Creative N-Line ne dépend pas d'une prise externe, ce qui simplifie son usage quotidien. La batterie de 1,49 kWh permet une autonomie électrique théorique de 128 km en cycle WLTP mixte, mais en réalité, elle se limite à 2-4 km en mode pur EV, priorisant l'assistance au thermique pour une consommation globale de 5,8 l/100 km (essence 95). Sur un plein de 54 litres, cela équivaut à environ 800-900 km d'autonomie totale, idéal pour les longs trajets sans contrainte de recharge.
La recharge se fait automatiquement via le freinage régénératif (ajustable via palettes) ou en descente, récupérant jusqu'à 30 % d'énergie en usage urbain. Pas de Wallbox ni de câble fourni, ce qui évite les complications mais limite l'efficacité en ville par rapport à un PHEV. Critiquement, l'absence de mode EV prolongé déçoit dans les zones à faibles émissions (ZFE), où le passage fréquent à l'essence augmente la conso à 7-8 l/100 km. Pour les flottes, cela signifie une dépendance au réseau essence, mais avec un TCO avantageux grâce à la sobriété. Imaginez un parcours mixte : ville silencieuse le matin, autoroute économique l'après-midi, sans jamais s'inquiéter d'une borne. Pour des conseils sur la transition vers l'électrique, explorez notre article sur les avantages des véhicules électriques pour les TPE et PME.
Le Tucson Creative N-Line brille par son arsenal technologique, au diapason des standards 2025. L'infodivertissement repose sur deux écrans 12,3 pouces (navigation, multimédia, compteurs) avec interface Bluelink intuitive, compatible Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Les commandes vocales "Hey Hyundai" gèrent climatisation, navigation et appels avec précision, tandis que l'audio Bose 8 haut-parleurs enveloppe l'habitacle d'un son clair, même à vitesse soutenue.
Côté sécurité, le pack Hyundai SmartSense est complet : freinage d'urgence autonome (FCA) avec détection piétons/cyclistes, maintien dans la voie actif (LKA), régulateur adaptatif intelligent (SCC) et surveillance angles morts (BCW). La caméra 360° HD et le moniteur de fatigue du conducteur ajoutent une couche de sérénité. Critiquement, l'écran tête haute (option 700 €) projette les infos essentielles sans distraire, mais l'absence de réalité augmentée (comme chez certains concurrents) limite l'innovation. Les ports USB-C multiples et la charge sans fil 15W facilitent la connectivité pro. On visualise un conducteur en visio-conférence, smartphone rechargé, alertes trafic en temps réel guidant vers une réunion sans stress. Pour optimiser la gestion de flotte, découvrez Evera Fleet.

Tarifé à 43 750 € TTC en finition Creative N-Line 2025, le Tucson Hybrid 215 se positionne en milieu de gamme des SUV hybrides compacts, incluant de série toit ouvrant panoramique, sièges ventilés et caméra 360°. Ajoutez 2 000 € pour le 4x4 HTRAC et 800 € pour la suspension adaptative, portant le total à près de 47 000 € bien équipé. En LLD via Evera Lease, les loyers mensuels tournent autour de 500-600 € HT (36 mois, 30 000 km/an), avec entretien inclus, rendant l'offre attractive pour les entreprises.
Fiscalement, ses 8 CV fiscaux et vignette Crit'Air 1 minimisent la TVS (environ 200 €/an) et l'AEN (réduite de 20 % pour hybrides). Cependant, face à l'inflation des malus CO2, son prix d'entrée élevé (sans bonus écologique pour HEV) le rend moins compétitif qu'un EV subventionné. Le TCO reste bas grâce à la fiabilité Hyundai (garantie 5 ans/km illimité) et la revente soutenue. Critiquement, des options comme les jantes 19" augmentent la facture sans gain essentiel. Pour les pros, c'est un investissement rentable sur 4 ans, mais calculez précisément avec notre outil Car Policy.
Dans le segment des SUV hybrides compacts, le Tucson Creative N-Line 2025 se mesure au Toyota RAV4 Hybrid (47 000 €, plus fiable mais moins fun), au Kia Sportage Hybrid (42 000 €, cousin partageant la plateforme pour une fiabilité similaire mais design moins audacieux) et au Peugeot 3008 Hybrid (45 000 €, plus stylé intérieurement mais conso plus élevée). Face au Ford Kuga PHEV (48 000 €, avec 50 km EV mais recharge obligatoire), il gagne en simplicité d'usage.
Ses atouts : couple généreux et tech avancée surpassent le Nissan Qashqai e-Power (40 000 €, plus bruyant), tandis que le design N-Line le distingue du Mazda CX-5 Hybrid (44 000 €, plus routier mais moins connecté). Faiblesses : autonomie EV limitée par rapport aux PHEV, et prix supérieur au Renault Austral Hybrid (41 000 €). Globalement, il excelle en polyvalence pour un usage mixte, idéal pour flottes cherchant équilibre sans extrêmes. Pour comparer fiscalement, consultez notre guide sur la réforme des AEN 2025.
Le Hyundai Tucson Hybrid 215 Creative N-Line 2025 s'impose comme un SUV hybride convaincant, alliant design sportif, technologies avancées et consommation maîtrisée pour un usage professionnel ou familial. Ses points forts – polyvalence routière, habitacle high-tech et fiscalité avantageuse – en font un choix stratégique pour les entreprises en transition verte, sans les contraintes des EV purs. Cependant, l'autonomie EV modeste et le prix élevé tempèrent l'enthousiasme face à des rivaux plus innovants. Bilan : recommandé pour qui cherche un hybride fiable et fun, prêt à affronter 100 000 km sans sourciller. Chez Evera, il intègre parfaitement nos solutions de LLD pour optimiser votre mobilité durable.

.svg)
.svg)
La Renault R5 E-Tech dans sa version Autonomie Confort marque le retour d'un mythe automobile dans une ère électrique, avec une approche qui mêle héritage design et innovations contemporaines. Lancée en 2025, cette citadine compacte cible les conducteurs urbains et périurbains à la recherche d'une mobilité zéro émission accessible, tout en intégrant des technologies avancées pour une utilisation quotidienne fluide. Basée sur la plateforme AmpR Small dédiée à l'électrique, elle propose une motorisation de 150 ch et une batterie de 52 kWh, offrant une autonomie WLTP de 410 km. Son positionnement tarifaire, autour de 35 000 € pour cette finition Iconic, la place dans un segment compétitif où l'équilibre entre style, praticité et efficacité énergétique est primordial. Cet essai explore ses forces et ses limites, en mettant l'accent sur un ressenti routier immersif et une analyse critique des performances réelles.
Dès le premier regard, la Renault R5 évoque une renaissance réussie, où le design rétro de l'originale des années 1970 rencontre la modernité d'une citadine électrique. Sa silhouette trapue, longue de 3,92 m, arbore des lignes arrondies et un capot court qui rappellent fidèlement l'esprit ludique de ses aînées, tout en intégrant une calandre fermée typique des VE et des feux LED effilés pour une signature lumineuse distinctive. L'accès à bord s'avère aisé grâce à des portes largement ouvrantes, et l'intérieur respire immédiatement une qualité perçue supérieure, avec des matériaux recyclés et une ergonomie intuitive. Le silence ambiant au démarrage électrique invite à une conduite sereine, mais l'absence de vibrations thermiques peut surprendre les habitués des moteurs classiques. Globalement, ces premières sensations instillent une promesse de plaisir quotidien, bien que le poids de la batterie (environ 1 400 kg à vide) se fasse sentir dans une certaine inertie initiale.

Le design extérieur de la R5 est sans conteste son atout maître, un exercice de style qui capture l'essence joyeuse de l'originale tout en s'adaptant aux exigences aérodynamiques d'un véhicule électrique. Les proportions compactes – empattement de 2,58 m, hauteur de 1,54 m – confèrent une agilité visuelle idéale pour la ville, renforcée par des jantes de 18 pouces en alliage qui ajoutent une touche premium sans alourdir excessivement la ligne. La palette de couleurs vives, incluant des teintes pop comme le Pop Yellow ou l'Orange Pop, renforce son caractère attachant, tandis que les inserts chromés sur les passages de roues et le toit panoramique optionnel (non inclus de série en Confort) apportent une élégance subtile. Critiquement, les rétroviseurs extérieurs pourraient gagner en finesse pour réduire la traînée aérodynamique, et les essuie-glaces à balayage intermittent manquent parfois de réactivité sous forte pluie. Néanmoins, cette esthétique distinctive la distingue favorablement dans un parking urbain, où elle attire les regards sans verser dans l'excès. Imaginez-vous slalomant entre les files de circulation, avec cette silhouette iconique qui évoque les publicités vintage tout en glissant silencieusement. Pour comparer avec d'autres designs iconiques, découvrez notre essai de la Fiat 500e.
À l'intérieur, la R5 offre un habitacle spacieux pour sa catégorie, avec une hauteur sous plafond généreuse (1,40 m à l'avant) qui permet une position de conduite surélevée et naturelle, idéale pour une visibilité optimale en milieu urbain. Les sièges en tissu recyclé, chauffants de série, enveloppent correctement le conducteur et le passager avant, avec un soutien lombaire ajustable qui atténue les trajets prolongés. Le tableau de bord minimaliste, dominé par un double écran incurvé de 10 pouces (instrumentation) et 10,1 pouces (multimédia), crée une ambiance high-tech immersive, où les commandes vocales et tactiles répondent avec fluidité. Cependant, l'espace arrière reste limité pour trois adultes – les genoux frôlent les dossiers avant – et le coffre de 277 litres (extensible à 887 litres sièges rabattus) peine à avaler des bagages volumineux, un point faible pour les familles ou les professionnels nomades. Les rangements sont astucieux, comme le vide-poches central éclairé, mais l'absence de bec de casseau et les plastiques durs sur les contre-portes trahissent un budget contenu. On s'y sent comme dans un cocon moderne, avec une insonorisation remarquable qui isole des bruits extérieurs, mais une modularité accrue aurait été bienvenue.

La motorisation électrique de 150 ch (110 kW) et 245 Nm de couple instantané propulse la R5 avec une réactivité exemplaire, atteignant 0 à 100 km/h en 8 secondes et une vitesse maximale limitée à 150 km/h. Ce bloc synchrone à aimants permanents, couplé à une boîte automatique à variation continue, délivre une accélération linéaire sans à-coups, particulièrement appréciable en sortie de feu rouge ou lors d'insertions autoroutières. La batterie de 52 kWh, logée sous le plancher pour un centre de gravité bas, contribue à une tenue de route stable, avec une suspension qui absorbe bien les irrégularités urbaines sans compromettre la dynamique. Les modes de conduite – Eco, Sport et Personnalisé – permettent une personnalisation fine, le mode Sport libérant toute la cavalerie pour des sensations vives, tandis que l'Eco optimise la sobriété. Critiquement, la consommation mixte réelle avoisine 15 kWh/100 km en conduite dynamique, un peu au-dessus de la moyenne du segment, et l'absence de version plus puissante limite son appel aux amateurs de sportivité. On imagine aisément des trajets fluides sur routes secondaires, où le couple généreux masque la masse, mais les longues montées autoroutières révèlent une réserve modérée.
Sur route, la R5 démontre une agilité remarquable en environnement urbain, où son rayon de braquage réduit (10,4 m) et sa compacité facilitent les manœuvres serrées et les stationnements en épi. La direction assistée électrique, précise et communicative, offre un ressenti direct qui incite à une conduite engagée, tandis que les pneus Michelin e.Primacy en 205/45 R18 assurent une adhérence saine sans excès de bruit de roulement. En mode mixte, sur un parcours de 50 km incluant ville et périphérique, elle maintient une consommation de 14,5 kWh/100 km, avec une récupération d'énergie au freinage (paramétrable sur trois niveaux) qui recharge subtilement la batterie lors des décélérations. Sur autoroute, à 130 km/h, le confort acoustique reste élevé grâce à une insonorisation renforcée, mais le vent latéral peut la déstabiliser légèrement en raison de sa hauteur, et la vitesse de pointe bridée impose une vigilance accrue face aux flux rapides. Les freins, à récupération régénérative, dosent bien la décélération, mais pédale droite un peu spongieuse en freinage d'urgence. Globalement, elle excelle dans son domaine – la mobilité quotidienne – mais manque de polyvalence pour des voyages longs sans recharge, un équilibre typique des citadines électriques. Visualisez-vous naviguant dans le trafic dense, où son silence et sa réactivité transforment les embouteillages en moments zen. Notre essai routier de la Peugeot e-208 offre un benchmark pertinent dans le segment.

Avec une autonomie WLTP de 410 km, confirmée à environ 350 km en conditions réelles mixtes (froid modéré, charge à 80 %), la R5 Autonomie Confort s'avère adaptée aux trajets urbains et périurbains, couvrant sans effort une semaine de commuting pour un utilisateur moyen. La consommation varie de 14 à 16 kWh/100 km selon le style de conduite et la température, aidée par une pompe à chaleur de série qui préserve l'autonomie en hiver (perte limitée à 10-15 %). La recharge AC sur prise domestique (7,4 kW) prend 7-8 heures pour une charge complète, tandis que le chargeur embarqué 11 kW triphasé réduit cela à 4-5 heures sur wallbox, idéal pour une nuit au garage. En DC rapide, jusqu'à 100 kW, elle passe de 20 à 80 % en 30 minutes, un atout pour les pauses autoroutières. L'innovation de la charge bidirectionnelle (V2L jusqu'à 3,7 kW et V2G compatible) permet d'alimenter des appareils externes ou de revendre de l'énergie au réseau, une fonctionnalité prospective pour les flottes intelligentes. Cependant, la courbe de charge n'est pas la plus plate du segment, et l'absence de pré-conditionnement automatique de la batterie peut allonger les temps en hiver. Imaginez recharger en 25 minutes lors d'un arrêt café, reprenant la route avec 300 km d'autonomie fraîchement regagnés.
La R5 brille par son arsenal technologique, centré sur le système OpenR Link avec Google Automotive Services intégré, qui transforme l'écran central de 10,1 pouces en hub multimédia fluide. La navigation inclut un planificateur EV natif qui intègre les bornes Ionity et autres réseaux, suggérant des itinéraires optimisés avec marge de sécurité sur l'autonomie restante. Les aides à la conduite de niveau 2 – Active Driver Assist avec régulateur adaptatif Stop & Go, maintien dans la voie et freinage d'urgence – fonctionnent de manière réactive sur autoroute, réduisant la fatigue sur longs trajets. Le pack parking mains-libres, avec caméras 360° et capteurs ultrasoniques, facilite les manœuvres en site contraint, tandis que le My Safety Switch permet de personnaliser les alertes (détection d'angle mort, vigilance conducteur) via un bouton unique. La connectivité 5G assure une mise à jour over-the-air fluide, et l'assistant vocal Reno répond aux commandes naturelles. Critiquement, l'interface tactile peut saturer en multitâche, et l'absence de Apple CarPlay natif (seulement Android Auto sans fil) limite les utilisateurs iOS. On s'immerge dans un cockpit digital où chaque interaction semble anticipée, rendant la conduite plus sereine et productive.

Tarifée à partir de 34 900 € en finition Techno Autonomie Confort (avant bonus écologique de 4 000 €), la R5 se positionne en milieu de gamme des citadines électriques, offrant un bon rapport équipement/prix avec sa batterie 52 kWh et ses technologies incluses. Ce prix inclut de série la pompe à chaleur, les sièges chauffants et le régulateur adaptatif, justifiant une prime par rapport à des rivales plus basiques. Le TCO reste compétitif grâce à une consommation modérée (environ 0,15 €/km en tarif bleu EDF) et des coûts d'entretien annuels inférieurs à 300 €, sans vidange ni courroie. Cependant, les options comme le toit ouvrant (800 €) ou les jantes 18'' (500 €) font vite grimper la facture, et sans bonus, elle frôle les 39 000 €, un seuil psychologique élevé pour le segment. Fiscalement, elle bénéficie de l'exonération de TVS et du Crit'Air 0, un plus pour les entreprises. En bilan, elle vaut son prix pour les technophiles, mais les budgets serrés pourraient hésiter face à des alternatives moins chères.
Face à la Peugeot e-208 (autonomie 400 km, 37 000 €), la R5 se démarque par son design plus charismatique et sa charge bidirectionnelle absente chez la rivale, bien que l'e-208 offre une habitabilité arrière supérieure. L'Opel Corsa Electric (349 km WLTP, 33 000 €) est plus abordable mais moins équipée en ADAS, tandis que la Fiat 600e (autonomie 410 km, 36 000 €) rivalise en style italien mais manque de la connectivité Google native de la R5. La Volkswagen ID.3 (430 km, 38 000 €) propose plus d'espace mais un design plus anonyme et une recharge plus lente en entrée de gamme. Critiquement, la R5 pâtit d'une consommation légèrement supérieure à la MG4 (autonomie 450 km pour 28 000 €), rendant cette dernière plus économique pour les gros rouleurs. Néanmoins, son héritage culturel et ses innovations (V2G, My Safety Switch) lui confèrent un avantage émotionnel et pratique, la positionnant comme un choix premium accessible dans un marché saturé.
En conclusion, la Renault R5 E-Tech Autonomie Confort récolte une note globale de 8/10, saluée pour son design iconique, sa connectivité avancée et son autonomie adaptée à la vie moderne, qui en font une compagne idéale pour les urbains en transition électrique. Ses points forts – réactivité, silence et technologies immersives – compensent largement les faiblesses comme l'espace arrière limité et une consommation perfectible. Elle s'impose comme un véhicule d'image pour les particuliers soucieux de style et d'écologie, tout en convenant aux flottes pour son TCO maîtrisé. Bilan : un succès Renault qui ravive la flamme d'une légende, prouvant que l'électrique peut être fun et pratique sans sacrifier l'essentiel.
Autonomie estimée : — km
* Estimation Evera Lease — données indicatives selon vitesse, température et charge.

.svg)
.svg)
La Renault Clio E-Tech Full Hybrid 145 ch millésime 2025 représente l'évolution attendue d'une icône de la citadine polyvalente, intégrant la technologie hybride non rechargeable pour répondre aux exigences croissantes de sobriété et de flexibilité en entreprise. Ce modèle, disponible en finitions Évolution, Équilibre et supérieures, vise à démocratiser l'hybride sans imposer les contraintes de la recharge externe. À travers cet essai, nous explorons ses atouts et ses limites, en nous basant sur un test routier couvrant plus de 400 kilomètres en conditions mixtes urbaines, périurbaines et autoroutières.
Dès les premiers regards, la Clio E-Tech 2025 impose une présence affirmée sans excès, avec une silhouette compacte (4,05 m de long) qui respire la maturité. L'extérieur modernisé, inspiré des derniers langages stylistiques Renault, offre une allure dynamique sans verser dans l'agressivité gratuite. À l'approche, les feux LED en forme de C signature s'allument avec une élégance discrète, et la calandre élargie donne une impression de robustesse accrue par rapport à la génération précédente. Une fois au volant, le silence ambiant – grâce au mode électrique par défaut – surprend agréablement, invitant à une conduite zen dès le démarrage. On apprécie immédiatement la fluidité de la boîte automatique E-Tech, qui évite les à-coups des hybrides concurrents. Cependant, les plastiques extérieurs paraissent un peu trop utilitaires, rappelant que cette Clio reste avant tout une voiture pragmatique plutôt qu'un objet de désir. Pour les gestionnaires de flotte, cette première prise en main évoque une alliée fiable pour les trajets quotidiens, loin des complications des full électriques.
Le design extérieur de la Clio E-Tech 2025 affine les lignes de sa devancière sans révolution, optant pour une évolution mesurée qui privilégie l'aérodynamisme et la compacité. La face avant, dominée par la calandre "en losange" élargie et les phares LED affûtés, confère une expression plus assurée, presque SUV-like, qui s'harmonise bien avec les jantes de 16 pouces en alliage (de série sur Équilibre). Les flancs sculptés, avec des passages de roue marqués, accentuent la posture athlétique, tandis que l'arrière gagne en modernité grâce à des feux traversants et un becquet subtil. Les coloris bi-ton (comme le Bleu Ironstone avec toit noir) ajoutent une touche de personnalisation accessible, idéale pour différencier une flotte d'entreprise.
Critiquement, les proportions restent celles d'une citadine classique : empattement de 2,58 m pour une habitabilité optimisée en ville, mais sans l'audace stylistique des rivales comme la Peugeot 208. Les rétroviseurs électriques rabattables et les capteurs de stationnement facilitent les manœuvres en environnement urbain dense, mais l'absence d'options comme des jantes 17 pouces en entrée de gamme limite l'attrait visuel. On imagine aisément cette Clio garée en ligne dans un parking d'entreprise, discrète et efficace, sans attirer les regards superflus. Pour en savoir plus sur les alternatives stylées en citadine électrique, consultez notre essai de la Peugeot E-208 GT 2025.

L'aérodynamisme (Cx de 0,30) est un atout discret, aidé par des prises d'air actives et un soubassement caréné, contribuant à la sobriété hybride. Les finitions extérieures, avec des inserts chromés sur les versions supérieures, résistent bien aux usages intensifs, mais les bas de caisse plastiques trahissent une vocation utilitaire.
À bord, la Clio E-Tech 2025 propose un habitacle fonctionnel et ergonomique, mais sans le raffinement premium attendu en 2025. L'espace avant est généreux pour une citadine, avec des sièges enveloppants et un volant cuir (optionnel) qui offre une bonne prise en main. La planche de bord, dominée par l'écran tactile 10 pouces en portrait, centralise les commandes avec une interface OpenR Link intuitive, responsive pour la navigation et les réglages multimédia. Les matériaux mixtes – soft-touch sur le tableau de bord, plastiques durs ailleurs – conviennent à un usage professionnel, mais manquent de chaleur comparés aux rivales japonaises.
L'habitabilité arrière déçoit légèrement : deux adultes s'y installent confortablement pour des trajets courts, mais les genoux et la garde au toit (1,88 m) limitent les longs voyages à trois. Le coffre, amputé à 285 litres par la batterie sous le plancher, reste pratique pour des sacs ou des échantillons d'entreprise, avec un hayon large facilitant les chargements. On apprécie les rangements astucieux (console centrale coulissante, poches aérées) et la climatisation auto bi-zone, mais les vibrations résiduelles du moteur 1.6 essence en mode hybride rappellent les compromis techniques. Globalement, cet intérieur évoque un bureau roulant efficient, adapté aux commerciaux nomades, mais sans le wow-factor pour fidéliser les conducteurs exigeants.

La banquette 60/40 rabattable libère 1 138 litres, idéal pour des outils ou bagages occasionnels. Les inserts ambient lighting en bleu ajoutent une touche moderne la nuit, mais l'absence de sièges chauffants de série sur Évolution freine le score.
La motorisation E-Tech Full Hybrid 145 ch combine un bloc essence 1.6 litres atmosphérique de 94 ch à deux moteurs électriques (un principal de 49 kW et un starter/générateur), pour une puissance cumulée de 145 ch et 250 Nm de couple instantané. Cette architecture, dérivée des technologies Formule 1 de Renault, dispense d'embrayage traditionnel et de boîte manuelle, favorisant une répartition fluide entre modes électriques (jusqu'à 80 km/h en ville) et thermique. La batterie lithium-ion de 1,2 kWh se régénère via freinage et décélérations, sans besoin de prise externe, rendant le système auto-suffisant.
Critiquement, cette hybridation non rechargeable excelle en sobriété urbaine (environ 4,5 l/100 km observés), mais le 1.6 essence montre ses limites en accélération soutenue, avec un 0-100 km/h en 9,9 secondes. Le couple électrique assure des reprises vives (80-120 km/h en 6 s), sans le ronronnement flatteur d'un pur turbo. Pour les flottes, cette motorisation Crit'Air 1 réduit les coûts TVS et assure une vignette verte, tout en minimisant l'entretien (freins régénératifs moins sollicités). Elle s'impose comme un choix rationnel pour la transition hybride, loin des extrêmes électriques.
Sur route, la Clio E-Tech 2025 démontre une polyvalence remarquable, avec une tenue de route saine grâce à un châssis affiné et des suspensions McPherson avant/torsion arrière bien calibrées. En ville, le mode électrique domine, offrant un silence velouté et des manœuvres précises (diamètre de braquage de 10,4 m), idéal pour les livraisons ou les rendez-vous serrés. Les transitions hybrides sont imperceptibles, la boîte à 4 rapports thermiques et 2 électriques gérant les basculements sans heurts, pour une conduite "zéro stress" qui séduit les conducteurs pressés.
Sur voie rapide, l'agrément faiblit : à 130 km/h, le moteur essence monte en régime (3 500 tr/min), générant un bruit d'aspiration notable, et les reprises demandent un appui franc sur l'accélérateur pour dépasser sans mollesse. La direction assistée électrique est précise mais manque de feeling, et les pneus 195/55 R16 (Michelin Primacy) privilégient le confort sur l'adhérence sportive. En courbes, le roulis est contenu, mais l'absence de modes de conduite dynamiques (seulement éco/normal) limite les plaisirs. On visualise cette Clio avalant 500 km d'autoroute sans fatigue excessive, coffre chargé, pour un commercial en tournée, mais elle peine à exciter face à des rivales plus vives. Pour comparer avec une compacte hybride plus spacieuse, lisez notre essai de la Renault Symbioz E-Tech Full Hybrid 160 ch.

En montagne, la régénération assistée par palettes au volant optimise l'efficacité, mais la puissance cumulée reste modeste pour les cols raides. Consommation mixte réelle : 5,2 l/100 km sur notre parcours.
Non rechargeable, la Clio E-Tech 2025 brille par sa simplicité : la batterie de 1,2 kWh se remplit automatiquement via l'énergie cinétique, assurant jusqu'à 80 % des trajets urbains en tout électrique sans intervention. L'autonomie mixte WLTP atteint 900 km (réservoir de 39 litres), avec une consommation homologuée de 4,2 à 5,3 l/100 km selon finition et pneus. En test, nous avons relevé 5,8 l/100 km en mixte, incluant 200 km autoroutiers, confirmant une endurance remarquable pour une citadine.
Critiquement, cette absence de prise externe libère les gestionnaires de flotte des infrastructures de recharge, tout en offrant une vignette Crit'Air 1 et des émissions CO2 basses (96-108 g/km). Pas de contrainte d'heures de charge nocturne, juste une pompe essence occasionnelle. Pour évaluer l'impact sur le TCO, utilisez notre simulateur TCO gratuit, qui intègre ces données hybrides pour comparer avec les full électriques.
Le système B-mode (freinage renforcé) étend le roulement électrique, idéal pour les zones à faibles émissions, sans altérer l'autonomie globale.
La Clio E-Tech 2025 intègre un arsenal technologique adapté aux besoins professionnels, avec jusqu'à 20 aides à la conduite (ADAS niveau 2). De série sur Équilibre : régulateur adaptatif, maintien dans la voie, freinage d'urgence AEBS, et alerte de vigilance. L'écran 10 pouces OpenR Link gère la navigation Google intégrée, Apple CarPlay/Android Auto sans fil, et un assistant vocal Reno ("Hey Reno, trouve un parking"). La caméra 360° et le parking semi-autonome facilitent les manœuvres en site contraint.
Critiquement, l'interface est fluide, mais l'absence d'un combiné numérique full digital (7 pouces partiel) déçoit face aux concurrents. La connectivité Easy Link permet le suivi télématique basique, compatible avec des outils comme Evera Fleet pour les flottes. On apprécie la recharge sans fil pour smartphone et les 4 USB-C, rendant l'habitacle un hub connecté efficace. Cependant, les mises à jour over-the-air sont limitées aux cartes, pas aux fonctions critiques.
Cinq étoiles Euro NCAP, avec angle mort et sortie de voie active. Pour les pros, ces techs réduisent les sinistres, comme détaillé dans notre guide sur la sécurité en flotte.
Tarifée à partir de 23 700 € pour l'Évolution (145 ch, clim auto, écran 9 pouces), la Clio E-Tech grimpe à 25 600 € en Équilibre (jantes alliage, ADAS étendus) et 27 500 € en Techno (cuir partiel, caméra 360°). En LLD pro via Evera Lease, comptez 250-300 €/mois HT pour 36 mois/30 000 km, entretien inclus. Ce positionnement sous 30 000 € la rend accessible, avec un bonus hybride nul mais une TVS réduite (environ 100 €/an) et récupération TVA partielle.
Critiquement, le rapport qualité-prix est bon pour l'hybride, mais les options (pack confort à 800 €) gonflent vite la facture. Face aux malus thermiques croissants, elle amortit rapidement en entreprise, surtout avec le barème AEN 2025 favorable aux hybrides légers. Pour simuler vos économies fiscales, explorez notre simulateur Avantage en Nature 2025.
La Clio E-Tech 145 ch se positionne comme une alternative rationnelle à la Toyota Yaris Hybrid (119 ch, 24 500 €), plus fiable en image mais moins spacieuse et équipée. Face à la Peugeot 208 Hybrid 136 ch (26 000 €), elle gagne en autonomie (900 vs 700 km) et en modularité, mais perd en design chic et en silence absolu. La Honda Jazz e:HEV (109 ch, 25 000 €) offre un coffre magique (plus de 300 L), mais une puissance inférieure et une boîte moins fluide. En électrique pure, elle défie la Renault Zoe ou la Fiat 500e pour les urbains, sans les contraintes de recharge.
Critiquement, la Clio excelle en polyvalence hybride pour les flottes mixtes, mais sa finition et sa sportivité la placent derrière la Yaris en agrément global. Pour un débat approfondi, lisez notre article Hybride vs Électrique : lequel choisir en 2025 ?, qui compare ces motorisations pour les pros.
En bilan, la Renault Clio E-Tech Full Hybrid 145 ch 2025 s'affirme comme une citadine hybride pragmatique, parfaite pour les entreprises en transition vers le durable sans rupture brutale. Ses atouts en sobriété (5 l/100 km réel), autonomie étendue et simplicité d'usage en font un choix TCO-optimisé, surtout avec les incitations fiscales 2025. Cependant, ses limites en raffinement intérieur et en dynamisme routier tempèrent l'enthousiasme, la reléguant au rang de bonne élève plutôt que d'excellence. Pour les flottes urbaines ou mixtes, elle mérite une place, complétée par des outils comme Evera Fleet pour un suivi optimal. Si votre stratégie penche vers l'électrique pur, optez pour des alternatives plus radicales ; sinon, cette Clio hybride assure une mobilité sereine et économique.

.svg)
.svg)
Une conversation avec Laëtitia Rocca, Office Manager et Responsable de la flotte chez Corsica Sole, entreprise française pionnière dans les énergies renouvelables.
Corsica Sole a choisi Evera Fleet pour moderniser la gestion de ses véhicules répartis entre la Corse, le continent et les DOM-TOM. Laëtitia Rocca revient sur les défis rencontrés, les bénéfices concrets apportés par la plateforme et sa vision d’une mobilité plus structurée et durable.
.avif)
Evera : Pour commencer, Laëtitia, pouvez-vous nous présenter Corsica Sole et le rôle que joue la flotte automobile dans vos activités ?
Laëtitia : Corsica Sole est une entreprise française spécialisée dans la production d’énergie solaire. Nous avons commencé avec des parcs solaires au sol et des hangars photovoltaïques pour les agriculteurs, puis développé le stockage d’énergie, un domaine dans lequel nous sommes aujourd’hui leaders en Europe. Nous travaillons aussi sur la production d’hydrogène vert, à partir de l’énergie écrêtée de nos centrales solaires.
La flotte joue un rôle essentiel dans notre activité. Nos techniciens, prospecteurs et chefs de projet doivent se déplacer quotidiennement sur différents sites, souvent éloignés. Sans véhicules, impossible d’assurer la maintenance ou la prospection. Aujourd’hui, nous opérons près de 40 véhicules, répartis entre la Corse, le continent et les DOM-TOM.
« Avant Evera Fleet, c’était l’enfer administratif. »
Evera : Avant la mise en place d’Evera Fleet, quels étaient les principaux défis que vous rencontriez dans la gestion de votre flotte ?
Laëtitia : Quand j’ai repris la gestion, la plupart des véhicules étaient déjà en place, avec des contrats très hétérogènes : certains en achat, d’autres en location longue durée.
Je n’avais pas toujours accès aux contrats, ni une vision claire sur les véhicules présents dans les îles ou sur le continent.
La gestion à distance était compliquée, notamment pour le suivi des infractions : il fallait souvent “partir à la pêche aux infos” pour savoir qui conduisait quel véhicule à un moment donné.
Tout cela se faisait via plusieurs tableaux Excel : assurances, amendes, cartes carburant, télépéage, contrats… Rien n’était centralisé. C’était une vraie perte de temps.
Evera : Qu’est-ce qui vous a convaincue d’adopter Evera Fleet chez Corsica Sole ?
Laëtitia : Ce qui m’a convaincue, c’est la centralisation. Avec Evera Fleet, je peux gérer l’ensemble de la flotte sur une seule plateforme : véhicules, conducteurs, infractions, kilométrage, tout est connecté.
Quand une infraction arrive, je sais immédiatement à quel conducteur elle correspond.
Les remontées kilométriques me permettent aussi d’anticiper les renouvellements, que ce soit pour les véhicules achetés ou ceux en leasing.
Cela facilite le suivi et évite les dépassements de kilomètres prévus au contrat.
« Evera Fleet nous a permis de gagner en clarté, en efficacité et en sérénité. »
Evera : Quels bénéfices concrets avez-vous observés depuis l’utilisation d’Evera Fleet ?
Réponse Laëtitia : Le premier bénéfice, c’est le gain de temps. Dès que j’ai besoin d’une information, je la trouve en quelques clics, sans devoir appeler un conducteur ou chercher dans plusieurs fichiers.
C’est aussi un vrai atout pour les négociations de contrats : grâce aux remontées kilométriques, j’ai un recul précis sur les usages réels, ce qui me permet de mieux calibrer les nouveaux contrats de leasing.
« Les données kilométriques réelles nous permettent de mieux négocier les contrats et d’anticiper le renouvellement du parc. »
Evera : Vous avez également choisi deux véhicules électriques avec Evera Lease. Qu’est-ce qui a motivé cette décision ?
Laëtitia : Nous avons d’abord pris les véhicules électriques avec Evera Lease, puis adopté la plateforme Evera Fleet.
La location longue durée est aujourd’hui la formule la plus intéressante pour une entreprise : elle permet de renouveler régulièrement le parc et de s’adapter aux évolutions technologiques.
En tant que producteur d’énergie renouvelable, il était logique pour nous d’aller vers l’électrique.
Nous avons choisi des véhicules d’occasion récents plutôt que neufs, car un véhicule perd de la valeur dès le premier kilomètre. Cela évite la surproduction et nous permet de bénéficier d’un vrai recul sur la fiabilité des modèles.
Evera : Quel conseil donneriez-vous à une autre entreprise souhaitant structurer sa gestion de flotte ?
Laëtitia : Je dirais qu’il faut se structurer avant tout.
Avant de mettre en place une flotte, il est essentiel d’avoir une politique claire de gestion des véhicules, alignée sur la stratégie de l’entreprise.
Quand une flotte se développe trop vite sans cadre, chacun fait à sa manière : ça devient ingérable.
Mieux vaut prendre un peu de temps au départ pour créer une vraie base solide, centraliser les données et utiliser une plateforme comme Evera Fleet.
C’est ce qui permet d’éviter les erreurs, les doublons et les pertes de temps.
« Se structurer dès le départ, c’est la clé. Sinon, tout devient beaucoup plus compliqué. »
Evera : En quelques mots, que retenez-vous de votre collaboration avec Evera ?
Laëtitia : C’est une collaboration très fluide. L’équipe Evera est à l’écoute, réactive, et la solution évolue vite.
Grâce à Evera Fleet, nous avons gagné en visibilité, en efficacité et en sérénité.
C’est un vrai partenaire dans notre démarche de transition énergétique.

.svg)
.svg)
La Renault Symbioz E-Tech Full Hybrid 160 ch se positionne comme un acteur clé dans le segment des SUV compacts hybrides, particulièrement adapté aux besoins des flottes professionnelles en quête d'un équilibre entre efficacité énergétique et polyvalence quotidienne. Lancée en 2024 et affinée pour 2025, cette version hybride non rechargeable met l'accent sur une motorisation mature et une modularité accrue, tout en tenant compte des contraintes fiscales et environnementales actuelles. Dans cet essai, nous explorons ses atouts et ses limites à travers un regard critique, en nous basant sur des kilomètres accumulés en conditions réelles, pour aider les décideurs d'entreprise à évaluer sa pertinence.
Dès les premiers regards, la Renault Symbioz impose une présence équilibrée sur la route, avec des proportions qui évoquent un SUV compact familial sans excès. En s'installant au volant, l'ergonomie intuitive frappe : tableau de bord numérique clair, position de conduite surélevée qui offre une vue dégagée sur la circulation urbaine. Le démarrage en mode électrique silencieux instaure une atmosphère sereine, idéale pour les trajets professionnels matinaux. Globalement, ces premières impressions instillent confiance pour un usage mixte ville-route, avec une modularité qui promet de la flexibilité pour les équipes mobiles.
Le design extérieur de la Symbioz adopte une approche pragmatique, avec une longueur de 4,41 mètres qui la place idéalement entre compacte et SUV intermédiaire. La face avant, dominée par la signature lumineuse en C et une calandre active aérodynamique, lui donne un air dynamique sans verser dans l'agressivité. Les jantes de 18 pouces en finition Techno ajoutent une touche d'élégance, tandis que les lignes fluides du profil, soulignées par des arches de roues prononcées, optimisent le Cx à 0,30 pour une meilleure efficacité énergétique.
Comparé à des rivaux plus audacieux, la Symbioz manque un peu de charisme distinctif, se contentant d'un style consensuel qui plaira aux gestionnaires de flotte soucieux de neutralité. Elle s'intègre parfaitement dans un parc automobile d'entreprise, où l'esthétique passe au second plan derrière la fonctionnalité. Pour en savoir plus sur les choix de motorisation hybride dans ce segment, consultez notre comparatif hybride vs électrique.

À l'intérieur, la Symbioz excelle par son habitabilité généreuse pour un SUV compact, avec un empattement de 2,67 mètres qui libère un espace aux jambes arrière impressionnant – jusqu'à 180 mm en position standard. La banquette coulissante sur 160 mm, une rareté dans la catégorie, permet d'adapter l'habitacle aux besoins : mode passager pour les longs trajets professionnels ou mode coffre pour transporter du matériel. Le coffre, d'une capacité de 492 litres (extensible à 1 455 litres), avale sans peine valises et échantillons, avec un plancher plat qui facilite le chargement.
Les matériaux mixtes (sellerie tissu/Alcantara en finition Techno) offrent un bon compromis confort/durabilité, et les sièges avant chauffants maintiennent une température agréable lors des hivers urbains. L'écran tactile OpenR de 10,4 pouces, intégré à un cockpit numérique de 10,25 pouces, centralise les commandes avec une interface fluide, bien que les menus secondaires soient parfois surchargés. Les points faibles ? Les aérations centrales basses pour les passagers arrière et un isolation phonique perfectible sur l'autoroute, où le bruit de roulement s'invite. Pour les entreprises, cette modularité fait de la Symbioz un allié précieux pour les équipes nomades. Découvrez comment optimiser le TCO de tels véhicules avec notre simulateur dédié.

Ambiance et ergonomie quotidienne
En usage professionnel, l'éclairage d'ambiance paramétrable et les ports USB-C multiples (quatre au total) facilitent les recharges de smartphones lors de réunions itinérantes. La qualité perçue progresse par rapport aux anciennes générations, mais reste en deçà des standards coréens.

La motorisation E-Tech Full Hybrid 160 ch repose sur un système éprouvé : un bloc essence 1.8 atmosphérique de 109 ch (80 kW) associé à deux moteurs électriques, un principal de 50 ch pour la traction et un de 20 ch en générateur. La puissance cumulée atteint 160 ch et 205 Nm de couple instantané électrique, couplée à une batterie lithium-ion de 1,2 kWh rechargeable par récupération d'énergie. La boîte automatique multimode à 4 rapports thermiques et 2 électriques assure des transitions fluides sans embrayage classique, éliminant les à-coups en ville.
Cette architecture brille par son efficacité : 80 % des trajets urbains se font en mode électrique pur jusqu'à 105 km/h, avec un démarrage silencieux qui réduit le stress en embouteillage. Cependant, en accélération soutenue, le thermique monte rapidement en régime (jusqu'à 5 500 tr/min), générant un bruit rauque peu raffiné, et le couple limité à 205 Nm peine face à des hybrides plus puissants. Pour les flottes, cette sobriété (CO2 à 98 g/km, Crit'Air 1) minimise la TVS et les restrictions ZFE. Reliez cela à nos avantages fiscaux pour les hybrides en entreprise, qui s'appliquent aussi aux mild-hybrides comme celui-ci.
Performances techniques
0 à 100 km/h en 9,6 secondes, vitesse max à 175 km/h : suffisant pour un usage mixte, mais sans enthousiasme sportif.
Sur route, la Symbioz démontre une polyvalence remarquable. En ville, le mode hybride gère intelligemment les phases électriques, glissant sans effort dans le trafic parisien, avec une direction précise et une garde au sol de 18 cm qui absorbe les dos d'âne. Sur autoroute, la tenue de route reste stable jusqu'à 130 km/h, grâce à des suspensions bien calibrées qui filtrent les imperfections sans roulis excessif.
Critique : les pneus de série (215/55 R18) génèrent un bruit de roulement marqué au-delà de 110 km/h, et la direction manque de feeling en courbes serrées, privilégiant le confort sur le dynamisme.
Comportement en conditions variées
Sur routes secondaires sinueuses, le châssis Multilink arrière assure un équilibre neutre, mais le poids de 1 538 kg se fait sentir en montée.

Non rechargeable sur prise, la Symbioz mise sur une autonomie totale estimée à 1 000 km en cycle mixte WLTP, grâce à un réservoir de 52 litres et une consommation de 4,3 à 4,7 l/100 km. En mode électrique seul, environ 50-60 km en ville sont possibles, rechargés par freinage et décélération. Les tests réels confirment une moyenne de 4,5 l/100 km sur autoroute à 120 km/h, idéal pour les déplacements intersites sans contrainte de bornes.
Le point faible : l'absence de plug-in limite l'optimisation en zone urbaine dense, où un PHEV rival comme le Peugeot 3008 offrirait plus de km en EV. Pour les entreprises, cela simplifie la logistique, pas de câbles ni de planning de recharge, mais renforce la dépendance à l'essence. Avec notre offre Evera Lease, intégrez-la facilement dans une flotte hybride pour un TCO maîtrisé.
Efficacité énergétique réelle
En hiver, la consommation grimpe à 5,2 l/100 km, mais reste compétitive face aux thermiques purs.
La Symbioz embarque un arsenal complet pour 2025 : système ADAS niveau 2 avec régulateur adaptatif intelligent, maintien dans la voie actif et freinage d'urgence à 360°. L'OpenR Link intègre Google Built-in pour une navigation fluide et des mises à jour OTA, tandis que la caméra 360° et les capteurs de stationnement facilitent les manœuvres en parking d'entreprise. La connectivité 4G permet le suivi via l'app My Renault.
Sécurité et connectivité
Cinq étoiles Euro NCAP, avec sept airbags et détection de fatigue.
Tarif de base à 37 400 € en finition Techno, grimpant à 39 900 € pour la finition Esprit Alpine, la Symbioz se place dans la moyenne du segment. Sans malus écologique (CO2 <100 g/km), et avec une TVS réduite à 6 €/mois, le TCO en LLD (environ 450 €/mois sur 48 mois/60 000 km) séduira les flottes. Options comme le toit pano (+800 €) gonflent la facture, mais l'équipement de série (climat bi-zone, aide au stationnement) compense.
La Symbioz se mesure à la Toyota Corolla Cross Hybrid (175 ch, 38 900 €), plus fiable mais moins modulable ; au Kia Niro Hybrid (141 ch, 35 000 €), plus petit mais garanti 7 ans ; ou au Honda HR-V e:HEV (131 ch, 36 000 €), agile mais coffre plus petit. Elle surpasse le Peugeot 3008 Hybrid en habitabilité, mais pêche en agrément routier face à la fluidité Toyota.
Son atout : la banquette coulissante et le prix sans malus en font un choix pragmatique pour les entreprises françaises, où la fiabilité Renault progresse. Moins premium que le Hyundai Tucson, elle cible les budgets modérés.
La Renault Symbioz E-Tech Full Hybrid 160 ch s'affirme comme un SUV hybride pragmatique, idéal pour les flottes d'entreprise cherchant à verdir sans révolutionner leurs habitudes. Ses forces sont sa modularité, sa sobriété et sa fiscalité douce. Les faiblesses, comme le bruit moteur et un design consensuel, la relèguent à un rôle de second couteau face à des japonaises plus abouties. Pour les PME et ETI, elle représente un investissement rentable, surtout en LLD via Evera Lease. Si votre stratégie privilégie l'hybride non rechargeable, testez-la ; sinon, explorez nos essais électriques comparables pour une électrification plus poussée.

.svg)
.svg)
Introduction
La Volkswagen ID.7 Tourer Pro S, avec sa batterie de 86 kWh, représente une avancée significative dans le segment des breaks électriques haut de gamme. Destinée aux professionnels et aux gestionnaires de flotte, cette version grande batterie allie espace généreux, efficacité énergétique et technologies avancées, tout en respectant les exigences de mobilité durable. Disponible depuis début 2024, elle s'inscrit dans la stratégie d'électrification de Volkswagen, avec un accent sur l'autonomie et le confort pour les trajets professionnels longs.
Dès le premier regard, la Volkswagen ID.7 Tourer impose une présence élégante et moderne, avec ses lignes fluides qui évoquent une aérodynamique soignée, essentielle pour maximiser l'autonomie. Mesurant près de 4,96 mètres de long, elle arbore la signature lumineuse LED typique de la famille ID, avec des phares Matrix IQ.Light qui s'allument automatiquement pour balayer l'environnement. L'accès à bord se fait sans effort grâce à des portes généreuses et un seuil de chargement bas, tandis que le coffre de 605 litres (extensible à 1 714 litres) invite immédiatement à imaginer des voyages familiaux ou des chargements professionnels volumineux. L'ensemble respire la qualité allemande, avec une finition Pro S qui inclut des jantes de 19 pouces et des éléments chromés discrets. En s'installant au volant, la sensation de largeur et de hauteur sous plafond est immédiate, promettant un confort pour les longs trajets. Ce break électrique ne fait pas dans la provocation stylistique, mais mise sur une sobriété premium qui séduit les amateurs de rationalité et d'efficacité.
Le design extérieur de l'ID.7 Tourer s'inscrit dans la continuité de la berline ID.7, mais avec une silhouette allongée qui accentue sa vocation break. La calandre fermée, signature des électriques Volkswagen, contribue à un coefficient de traînée de 0,228, optimisé pour l'efficacité énergétique. Les flancs lisses, ponctués de prises d'air minimales, et le toit fuyant vers l'arrière soulignent une allure dynamique sans excès, tandis que les passages de roues musclés intègrent harmonieusement les pneus à faible résistance au roulement. À l'arrière, la lunette inclinée et les feux connectés en LED créent une signature visuelle distinctive, visible de loin sur autoroute. La modularité se révèle dans les détails : hayon électrique à ouverture large, toit panoramique optionnel qui inonde l'habitacle de lumière, et un châssis surélevé de 14 cm pour un meilleur dégagement au sol. En version Grande Batterie, elle pèse environ 2 200 kg, un poids maîtrisé pour sa catégorie, qui n'altère pas son équilibre visuel. Ce design n'est pas seulement esthétique ; il est pensé pour réduire la consommation, rendant chaque kilomètre plus économique, un atout précieux pour les flottes d'entreprise explorant les solutions de mobilité électrique professionnelle.

Silhouette polyvalente
La longueur accrue par rapport à la berline (17 cm de plus) permet d'accueillir jusqu'à 1 700 litres de volume utile, idéal pour transporter du matériel ou des bagages sans compromettre l'espace pour cinq passagers. Les coloris extérieurs, comme le Kings Red métallisé, ajoutent une touche de personnalisation sans alourdir le budget.
À l'intérieur, l'ID.7 Tourer Grande Batterie offre un habitacle immersif et high-tech, où la digitalisation domine sans sacrifier le confort physique. Les sièges ergonomiques en cuir synthétique ventilés et chauffants enveloppent les occupants, avec un réglage électrique pour le conducteur incluant une fonction mémoire. L'espace aux jambes arrière est généreux, surpassant celui d'une Passat traditionnelle, et les portes arrière s'ouvrent à 90 degrés pour un accès aisé. Le tableau de bord minimaliste met en vedette un écran incurvé de 15 pouces pour l'infodivertissement, flanqué d'un combiné numérique de 11,7 pouces configurable. Les matériaux recyclés et doux au toucher, combinés à un éclairage ambient à 30 couleurs, créent une ambiance premium et apaisante. Le coffre, avec son plancher plat et ses filets de rangement, facilite l'organisation, tandis que les sièges arrière rabattables 60/40 libèrent un espace plat. Pour les professionnels, l'intégration d'un chargeur sans fil pour smartphone et de multiples USB-C (dont un à l'arrière) rend les longs trajets productifs. Globalement, la vie à bord évoque une bulle de sérénité, où le silence électrique amplifie le sentiment de bien-être, aligné sur les attentes des voitures électriques pour les entreprises.

Ambiance et modularité intérieure
Les accoudoirs centraux coulissants et les aumonières astucieuses ajoutent à la praticité, tandis que l'insonorisation exemplaire – grâce à un pare-brise acoustique – isole des bruits extérieurs, transformant l'habitacle en un bureau roulant idéal.
Sous le capot, l'ID.7 Tourer embarque un moteur électrique synchrone à aimants permanents arrière de 210 kW (286 ch) et 545 Nm de couple instantané. Cette propulsion pure délivre une accélération de 0 à 100 km/h en 6,6 secondes, avec une vitesse maximale limitée à 180 km/h pour préserver l'autonomie. La batterie de 86 kWh, logée dans le plancher, abaisse le centre de gravité et optimise la répartition des masses (environ 55 % à l'arrière). Pas de transmission classique : un inverseur électronique gère les rapports de manière fluide, avec des modes de conduite (Eco, Comfort, Sport) qui modulent la réponse au pédalier. La consommation mixte WLTP s'établit à 15,2 kWh/100 km, un chiffre compétitif pour un break de cette taille. Cette motorisation se distingue par son rendement supérieur de 10 % par rapport à la génération précédente, grâce à une gestion thermique avancée et un refroidissement liquide efficace. Pour les flottes, cette efficacité se traduit par un TCO réduit, comme exploré dans notre simulateur TCO.
Performances mesurées
En conditions réelles, le couple généreux propulse le véhicule avec souplesse, idéal pour les insertions autoroutières ou les dépassements sans effort, tout en maintenant une consommation contenue.
Sur route, l'ID.7 Tourer excelle par son équilibre entre confort et dynamisme. Les suspensions adaptatives DCC (optionnelles) absorbent les irrégularités avec une souplesse remarquable, filtrant les vibrations sans talonnement excessif. À 130 km/h sur autoroute, le silence règne, seulement troublé par un léger ronronnement des pneus, tandis que l'assistance au maintien de voie guide le véhicule avec précision. En virages, la propulsion arrière offre une motricité saine, aidée par un mode Drift pour les âmes aventureuses, bien que le poids de la batterie rende le châssis prévisible plutôt qu'agile. La direction progressive, avec un diamètre de braquage de 11,4 mètres, facilite les manœuvres urbaines malgré la longueur. Lors d'un essai de 500 km mixtes (ville, route, autoroute), la consommation réelle s'est stabilisée à 16,5 kWh/100 km, confirmant l'efficacité en usage quotidien. Ce comportement routier polyvalent convient parfaitement aux professionnels effectuant de longs trajets, similaire à ce que nous avons observé dans notre essai de la Renault Mégane E-Tech.
Dynamique et confort
Les modes de régénération adaptative, ajustables via les palettes au volant, permettent de rouler en one-pedal driving fluide, réduisant les interventions au frein et optimisant l'énergie récupérée.
Avec une autonomie WLTP annoncée jusqu'à 702 km en jantes 19 pouces, l'ID.7 Tourer Grande Batterie bat des records pour un break électrique familial. En conditions réelles, elle avoisine les 550-600 km en mixte estival, descendant à 450 km en hiver avec chauffage actif. La consommation varie de 14 kWh/100 km en ville (grâce à la régénération) à 18 kWh sur autoroute à 130 km/h. La recharge AC à 11 kW complète la batterie en 8 heures sur une wallbox domestique, tandis que le DC à 200 kW permet de passer de 10 à 80 % en 28 minutes sur une borne Ionity. Le système Plug & Charge simplifie les sessions, et l'app We Connect optimise les itinéraires en intégrant les stations disponibles. Pour les entreprises, cette endurance réduit les arrêts, boostant la productivité ; des conseils pour gérer l'autonomie sont essentiels. Avec nos solutions de recharge, l'ID.7 s'intègre parfaitement dans une flotte équipée.

Autonomie estimée : — km
* Estimation Evera Lease — données indicatives selon vitesse, température et charge.
Stratégies d'optimisation
Le préconditionnement de la batterie via l'app prépare les sessions de charge rapide, minimisant les pertes d'énergie et préservant la durée de vie de la batterie (garantie 8 ans/160 000 km à 70 % de capacité).
L'arsenal technologique de l'ID.7 Tourer est impressionnant, centré sur une interface utilisateur intuitive. L'écran central de 15 pouces, sous ID. Software 3.0, gère navigation, climatisation et médias avec une fluidité remarquable, supportant Apple CarPlay et Android Auto sans fil. L'assistant vocal IDA, activé par "Hello IDA", commande jusqu'à 20 fonctions, y compris la recherche de stations de charge. Les aides à la conduite Travel Assist niveau 2+ maintiennent la trajectoire et adaptent la vitesse en fonction du trafic, avec un HUD projetant les infos clés sur le pare-brise. La caméra 360° et les capteurs IQ.Park facilitent les manœuvres en ville. Pour les pros, la connectivité eCall et les mises à jour OTA assurent une maintenance prédictive. Ces outils, comparables à ceux des meilleures applications pour EV, transforment chaque trajet en expérience connectée.

Sécurité et connectivité
Les 9 airbags, le freinage d'urgence autonome et la détection de fatigue veillent à la sécurité, tandis que l'intégration avec Evera Fleet permet un suivi en temps réel des véhicules de parc.
La Volkswagen ID.7 Tourer Grande Batterie Pro S débute à environ 65 000 € TTC en achat, mais brille en LLD chez Evera à partir de 650 €/mois (36 mois, 30 000 km/an, entretien inclus). Ce positionnement premium reflète la batterie généreuse et les équipements de série, avec des options comme le pack Tech (HUD, chargeur 22 kW) ajoutant 3 000 €. Fiscalement attractive – exonération de TVS, malus nul et récupération TVA possible – elle offre un TCO inférieur de 20 % à un diesel équivalent sur 4 ans. Pour les entreprises, les avantages fiscaux des EV amplifient sa rentabilité, rendant l'investissement amorti rapidement via économies d'énergie et image RSE.
Options et packs
Les finitions Style ou GTX (286 ch, AWD) grimpent à 70 000 €, mais la version base Grande Batterie reste compétitive pour son rapport espace/autonomie.
Face à la Hyundai Ioniq 6 (autonomie 614 km, prix 55 000 €) ou la Tesla Model 3 Long Range (629 km, 50 000 €), l'ID.7 Tourer se distingue par son format break, offrant plus d'espace que ces berlines. La BMW i5 Touring (582 km, 75 000 €) rivalise en premium, mais manque de l'autonomie supérieure de la Volkswagen. La Peugeot e-308 SW (autonomie 410 km) est plus compacte et abordable, tandis que la Skoda Superb iV hybride plug-in reste thermique. L'ID.7 excelle en modularité et recharge rapide, positionnant Volkswagen comme référence pour les breaks EV, comme dans notre top des meilleures EV 2024. Son argument : une autonomie réelle qui surpasse la concurrence en usage routier intensif.
Avantages comparatifs
Moins agile qu'une Tesla, elle surclasse en confort et volume, idéale pour les familles ou pros transportant du fret, avec un réseau de recharge étendu via VW.
En bilan, la Volkswagen ID.7 Tourer s'impose comme un break électrique mature, alliant autonomie exceptionnelle, confort premium et polyvalence pratique. Elle répond aux besoins des professionnels en transition écologique, avec un TCO optimisé et une intégration fluide dans les flottes. Si le prix d'accès reste élevé, ses atouts en endurance et espace en font un choix stratégique pour 2025 et au-delà. Chez Evera, elle mérite une place de choix dans les offres LLD, propulsant la mobilité d'entreprise vers un avenir durable.

.svg)
.svg)
Les utilitaires électriques offrent de nombreux avantages pour les artisans et les professionnels. Réduction des coûts d'exploitation, performances adaptées aux besoins, avantages concurrentiels... Découvrez comment ces véhicules peuvent révolutionner votre activité et vous faire gagner en productivité.
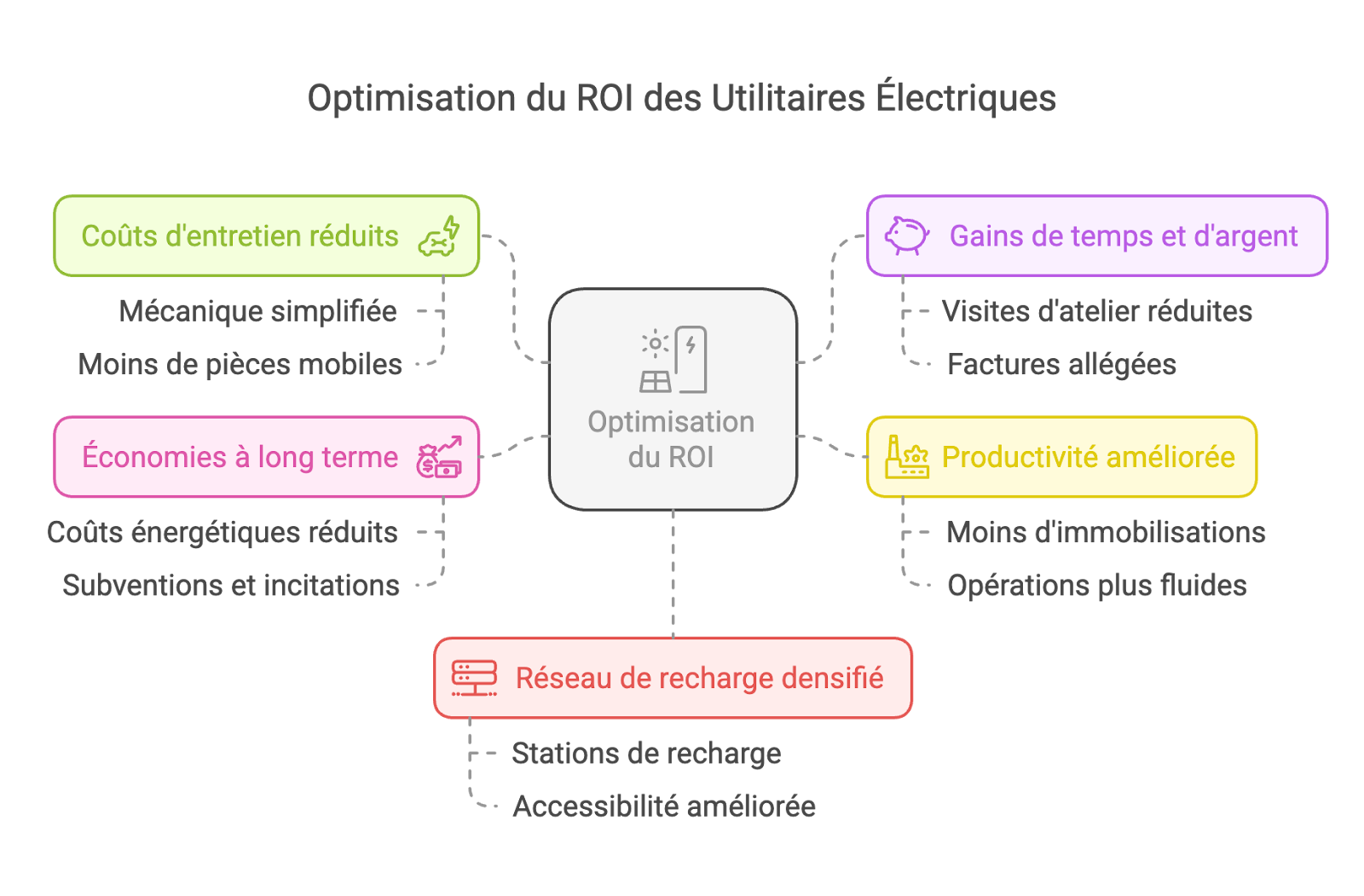
Les utilitaires électriques offrent des coûts d'entretien réduits grâce à leur mécanique simplifiée. L'absence de nombreuses pièces mobiles permet de diminuer significativement les visites à l'atelier et d'alléger les factures d'entretien.
Cette réduction des temps d'immobilisation pour maintenance a un impact positif sur la productivité des artisans. Moins de temps passé à l'atelier signifie plus de temps disponible pour réaliser des interventions et générer du chiffre d'affaires.
L'adoption d'un utilitaire électrique permet aux artisans de réaliser des économies substantielles sur le long terme. Les coûts d'utilisation réduits, combinés à la diminution des frais d'entretien, contribuent à optimiser le retour sur investissement de leur flotte automobile.
Sur une période d'utilisation de plusieurs années, ces économies peuvent représenter des milliers d'euros, renforçant ainsi la rentabilité de l'activité artisanale. Un argument de poids pour franchir le pas vers l'électrique.
L'expansion du réseau de recharge offre de nombreux avantages aux artisans :
Pour les artisans, cette expansion du réseau se traduit par un ROI approfondi grâce à la réduction des temps d'arrêt pour la recharge et l'augmentation de la productivité liée à une meilleure planification des trajets. L'accès garanti aux zones à faibles émissions (ZFE) dans les grandes villes avec un utilitaire électrique assure également la continuité des activités.
Les constructeurs proposent aujourd'hui une large gamme d'utilitaires électriques, avec des formats adaptés à chaque métier. Du petit fourgon compact au grand volume, en passant par les versions frigorifiques ou bennes, les artisans peuvent trouver le véhicule correspondant précisément à leurs besoins.
De plus, les autonomies ne cessent de progresser, avec des modèles offrant désormais plus de 300 km d'autonomie réelle. De quoi couvrir la majorité des tournées quotidiennes des professionnels sans appréhension.
Prenons l'exemple d'un plombier qui doit transporter son matériel et ses fournitures sur les chantiers. Avec un utilitaire électrique comme le Renault Kangoo Van E-tech, il bénéficie d'un volume de chargement jusqu'à 4,2 m3 et d'une autonomie de 260 km, largement suffisante pour ses déplacements journaliers. La recharge rapide permet de récupérer 170 km en seulement 27 min lors de la pause déjeuner.
Fini le temps où l'électrification rimait avec compromis sur les performances. Les utilitaires électriques récents offrent des capacités de charge et des volumes de chargement équivalents à leurs homologues thermiques.
Avec des charges utiles dépassant fréquemment la tonne et des volumes allant jusqu'à 20m3, ces véhicules répondent aux exigences des chantiers et livraisons les plus variés. La transition électrique se fait en douceur, sans bouleverser les habitudes de travail.
Pour optimiser l'espace de travail mobile, les constructeurs proposent des solutions d'aménagement sur-mesure selon les métiers. Étagères, tiroirs, établis, rangements spécifiques... Tout est prévu pour faciliter le quotidien des artisans.
Ces aménagements permettent de gagner en efficacité sur les chantiers, en ayant toujours le bon outil à portée de main. Ils participent également à renforcer l'image professionnelle de l'entreprise auprès des clients.
| Avantages des utilitaires électriques | Bénéfices pour les artisans |
|---|---|
| Large gamme de formats disponibles | Véhicule adapté à chaque métier |
| Autonomies dépassant les 300 km | Couverture des tournées quotidiennes sans souci |
| Capacités de charge préservées | Réponse aux exigences des chantiers sans compromis |
| Volumes de chargement jusqu'à 20m3 | Transport de matériel volumineux facilité |
| Aménagements sur-mesure | Optimisation de l'espace de travail mobile |
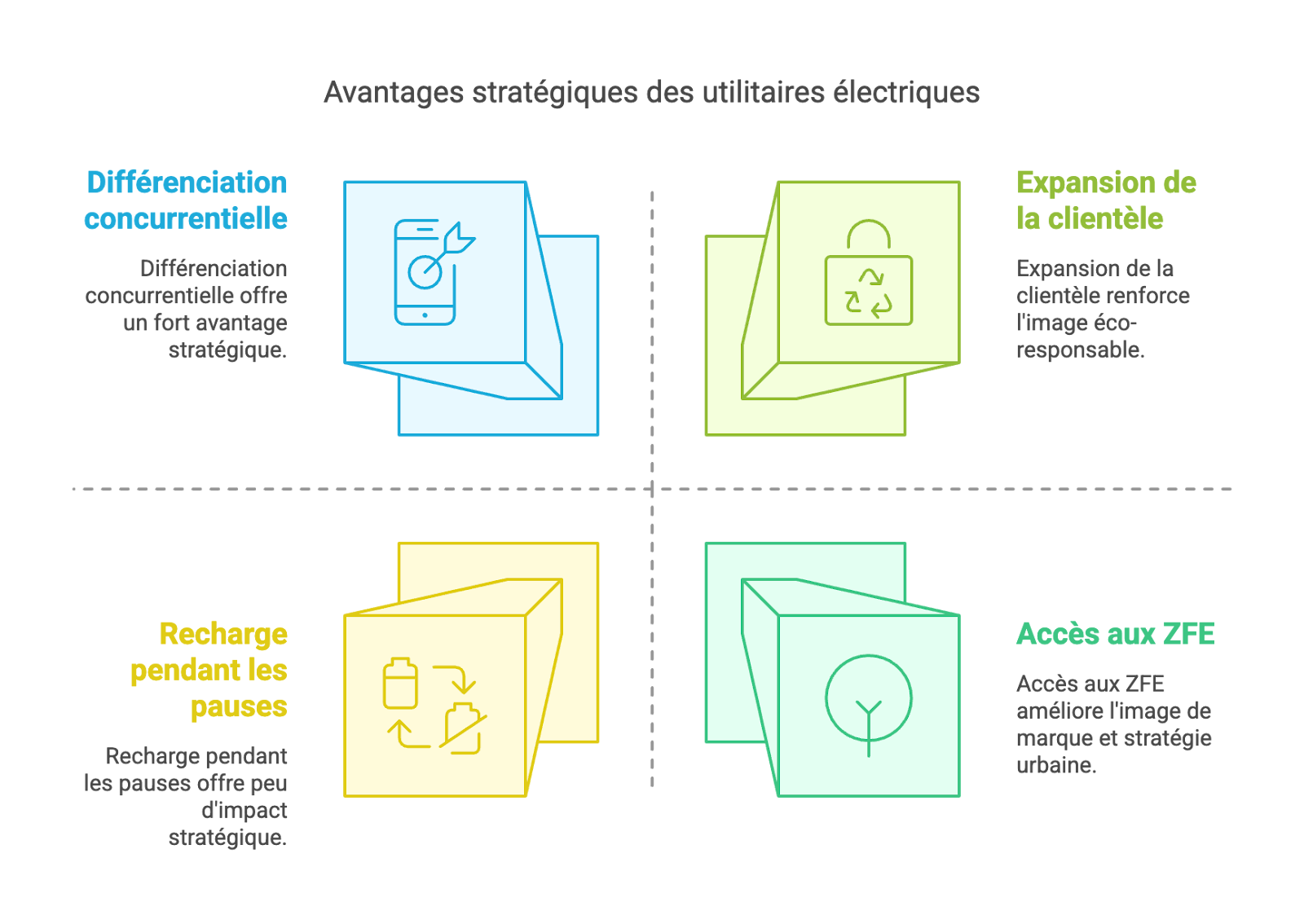
Opter pour un utilitaire électrique, c'est s'ouvrir à une nouvelle clientèle sensible aux enjeux environnementaux. De plus en plus de particuliers et d'entreprises privilégient les prestataires éco-responsables pour leurs travaux et services.
En communiquant sur cette démarche vertueuse, les artisans peuvent se démarquer de la concurrence et capter ce segment de marché en pleine expansion. Un avantage concurrentiel qui sera de plus en plus décisif à l'avenir.
Imaginons une entreprise d’électricien qui décide de convertir sa flotte d'utilitaires à l'électrique. En mettant en avant cet engagement écologique sur son site web, ses devis et ses véhicules, elle attire l'attention de clients soucieux de réduire leur empreinte carbone. Des clients prêts à la choisir face à des concurrents thermiques, pour des prestations à valeur ajoutée environnementale.
Au-delà de l'aspect purement commercial, l'adoption d'un véhicule électrique renforce l'image de marque de l'entreprise artisanale. Elle véhicule un message positif, tourné vers l'avenir et soucieux de l'impact environnemental de son activité.
Cette différenciation par les valeurs peut susciter l'adhésion et la fidélité des clients, mais aussi faciliter le recrutement de collaborateurs attachés à ces principes. De quoi bâtir une réputation d'entreprise responsable et innovante sur le long terme.
Avec la multiplication des zones à faibles émissions (ZFE) dans les grandes villes, les utilitaires électriques offrent un avantage concurrentiel. Ils garantissent aux artisans un accès pérenne à ces zones, leur permettant de continuer à travailler auprès de leur clientèle urbaine.
À l'inverse, les entreprises équipées de véhicules thermiques risquent de voir leur activité limitée, voire compromise, dans ces zones. Un risque qui ira croissant avec le durcissement programmé des restrictions de circulation.
En conclusion, les utilitaires électriques apportent de solides avantages aux professionnels : une réduction des coûts d'exploitation grâce à une maintenance simplifiée, des performances adaptées aux besoins de chaque métier et une image de marque renforcée auprès d'une clientèle sensible à l'éco-responsabilité. La densification du réseau de recharge et l'accès garanti aux ZFE sont également des atouts indéniables pour assurer la pérennité des activités.
En s'orientant vers une mobilité électrique, les artisans s'inscrivent dans une dynamique vertueuse, alliant performance économique et responsabilité environnementale. Une démarche porteuse de sens pour l'avenir de leur entreprise. Et si la transition vers l'électrique était la clé pour booster votre productivité tout en réduisant votre empreinte carbone ?

.svg)
.svg)



































Evera est une marque EVO GROUPE
©2025 EVO GROUPE tous droits réservés.
Nos équipes sont disponibles pour étudier vos besoins et répondre à vos questions.
.svg)
Absolument : Evera Fleet est un SaaS indépendant de notre service Evera Lease. Tous les véhicules sont compatibles avec notre solution, sans installation externe.
.svg)
Chez Evera, vous pouvez choisir votre véhicule en fonction de plusieurs critères : la marque, l'autonomie, le budget, la puissance et la catégorie. Evera propose un large choix de véhicules neufs ou reconditionnés pour répondre à vos besoins et envies.
.svg)
Evera Lease est en moyenne 20 % moins onéreux. Nous proposons des contrats flexibles, des véhicules neufs ou reconditionnés, des délais de livraison rapides (entre 72h et 3 semaines), un accompagnement dédié pour la prise en main des véhicules électriques, et l’accès à Evera Fleet, notre plateforme SaaS de gestion de flotte.
.svg)
Votre véhicule peut être livré chez vous ou au bureau sous 30 jours. Vous pouvez également choisir de récupérer gratuitement votre véhicule dans l'une des stations Evera.
La livraison rapide et flexible fait partie des avantages majeurs de Evera.
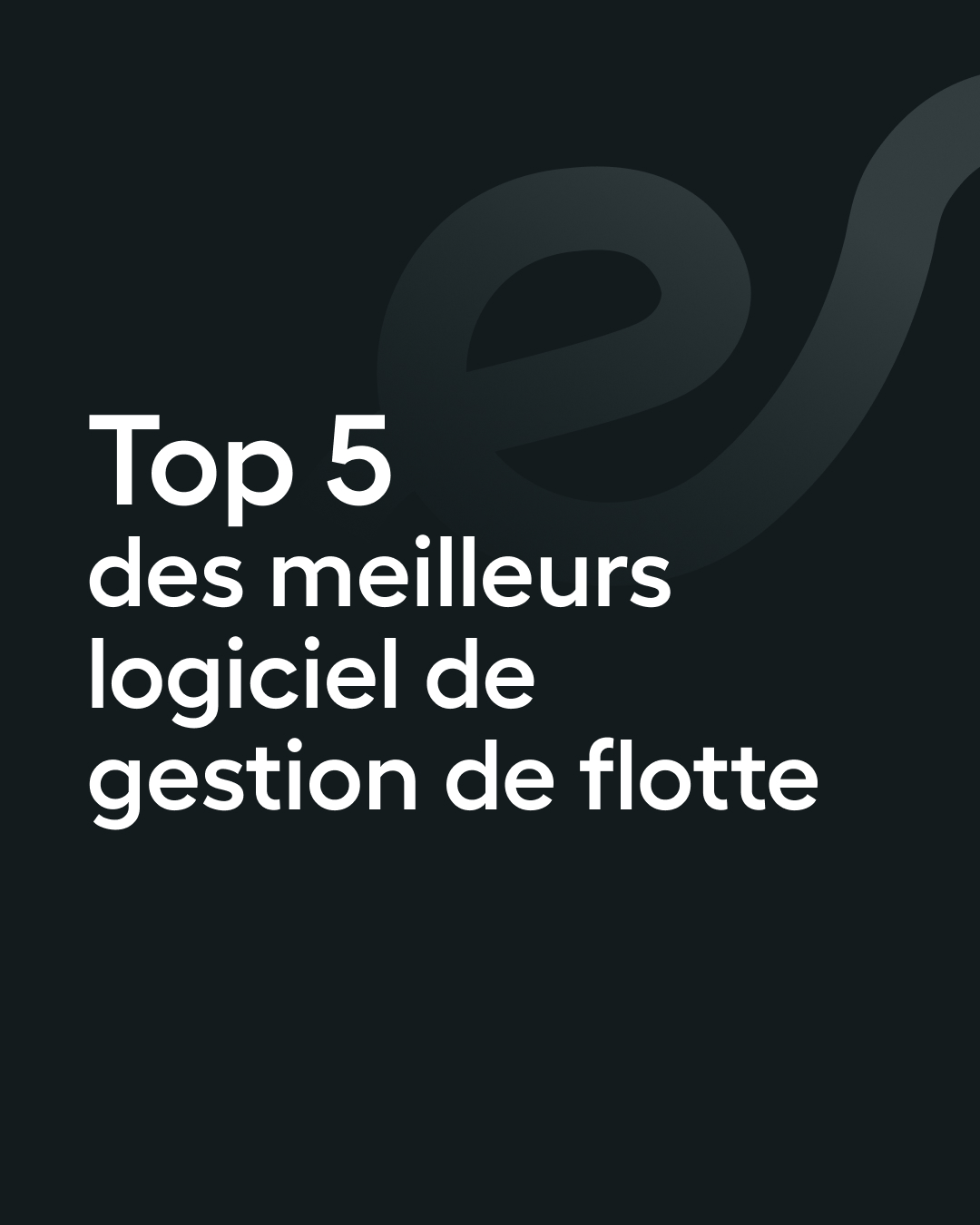





.svg)

.avif)
